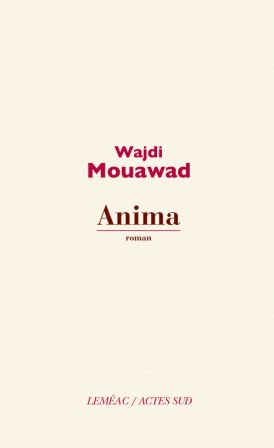 Alors qu’il rentre chez lui, un jour comme tant d’autres, Wahhch Debch, canadien d’origine libanaise, découvre le cadavre atrocement mutilé de sa femme baignant dans une rivière de sang. La vue du carnage réveille en lui de vagues images enfouies de son enfance.
Alors qu’il rentre chez lui, un jour comme tant d’autres, Wahhch Debch, canadien d’origine libanaise, découvre le cadavre atrocement mutilé de sa femme baignant dans une rivière de sang. La vue du carnage réveille en lui de vagues images enfouies de son enfance.
Le vélo pliant.« J’ai commencé à penser à moi le jour où j’ai trouvé la femme que j’aimais éventrée au milieu du salon dévasté. Il a fallu cette effroyable vision pour me mettre à penser à moi. Instantanément, j’ai vu le ventre dévasté de Léonie et je me suis revu dans le ventre dévasté de la terre, et depuis ça ne cesse de s’ouvrir. Je m’ouvre, quelque chose s’écartèle, et plus ça avance, plus ça me dissèque, plus je me disloque. »
Complètement abasourdi, Wahhch en vient à se demander s’il ne serait pas l’auteur de ce massacre. La seule façon pour lui d’en avoir le cœur net est que le coupable soit appréhendé. Mais de toute évidence la police ne semble pas pressée de le coincer.
Prenant les choses en main, il se lance, seul, sur les traces du meurtrier, sans aucune velléité de vengeance, ni pour faire justice. Simplement pour voir à quoi ressemble celui qui lui a ravi sa femme, et s’assurer du même coup que lui-même n’y est pour rien.
Sa traque le conduira du Canada aux États-Unis, jusqu’à une réserve indienne Mohawk, où l’inconnu s’est réfugié parmi des individus louches et dangereux qui font régner leurs propres lois.
Plus il se rapproche du meurtrier de Léonie, plus les souvenirs de Wahhch sont nets et saisissants, et plus il ressent le besoin pressant de reconsidérer sa propre histoire. Celle d’un orphelin adopté, seul de sa famille à avoir survécu au massacre de Sabra et Chatila.
Résumé ainsi à sa seule intrigue, Anima pourrait passer pour un polar super noir, ou un thriller haletant. Il n’est ni vraiment l’un, ni vraiment l’autre. Ou plus exactement, il est à la fois l’un et l’autre. Mais pas seulement.
Tout comme il ne déparerait pas au rayon des road-trips, épopées, tragédies antiques et autres odyssées mythologique, le deuxième roman du dramaturge Wajdi Mouawad pourrait aussi bien rejoindre la catégorie des récits initiatiques et quêtes d’identité.
« Je suis né d’un massacre il y a longtemps, ma famille a été saignée contre le mur de notre jardin, et aujourd’hui, des années plus tard, à des milliers de kilomètres de là, la mécanique du sang semble s’être remise en marche. De Léonie à Janice, de Janice à Chuck et son malheureux chien et de Chuck à Rooney, je revis, un à un, les meurtres qui m’oint vu naître. C’est comme un macabre jeu de piste qui se joue sur la terre d’Amérique où d’autres que moi, Indiens, colons, nordistes ou sudistes, ont traversé les mêmes carnages et je commence seulement à le pressentir. Ce n’est pas fini parce que ça continue à hurler et ça semble m’appeler de plus en plus, ça semble me nommer par mon propre nom. »
« Que faire des fragments éclatés de son histoire ? Fragments qu’il ne cesse de ressasser, incapable d’en raccorder les parties puisque le seul témoin de son désastre, qui l’a sorti de la fosse et l’a sauvé de la mort, ce père qui n’est pas son père mais qui l’a élevé comme son propre fils, refuse de parler de ce qu’il a vu et de ce qu’il a vécu, refuse de témoigner pour lui. » p. 325
Protéiforme, Anima est aussi polyphonique.
Les deux-tiers du roman sont en effet relatés par une succession de narrateurs pour le moins étonnants puisqu’il s’agit… d’animaux. Domestiques ou sauvages, endémiques ou exotiques, imposants ou microscopiques. Ainsi, tour à tour, chapitre après chapitre, sur plusieurs pages ou en quelques lignes seulement, chien, chat, lapin, canari, aigle, chimpanzé, mouffette, araignée… relatent la scène dont ils sont témoins, souvent invisibles aux yeux des protagonistes.
« Je reste là à regarder l’homme se dissoudre de nouveau à l’intérieur du brouillard. Nous, les chiens, percevons les émanations colorées que les corps des vivants produisent lorsqu’ils sont en proie à une violente émotion. Souvent, les humains s’auréolent du vert de la peur ou du jaune du chagrin et quelquefois encore de teintes plus rares : le safran du bonheur ou le turquoise des extases. Celui-là, épuisé, englouti par l’opacité opaline du chemin, exhale, depuis le centre de son dos, le noir de jais, couleur de la dérive et des naufrages, apanage des natures incapables de se départir de leur mémoire et de leur passé. »
Au gré des déclarations, parcellaires et fragmentées, concordantes ou contradictoires, les éléments se mettent en place. La vision kaléidoscopique des événements se resserre pour finir par révéler une réalité de plus en plus nette.
Felis sylvestris catus carthusianorum, Passer domesticus… S’il lui reste quelques notions de latin, le lecteur retrouvera facilement l’identité du narrateur qui entre en scène, puisque le titre de chaque chapitre correspond au nom scientifique de l’animal. Autrement, il s’amusera à la découvrir progressivement, en fonction des indices qui lui sont révélés dans le récit.
« CANIS LUPUS FAMILIARIS INAURATUS INVESTIGATOR
Vouant une adoration certaine à celle qui m’a intimé, de l’index, l’ordre de l’attendre devant les portes de l’épicerie, je n’ai pas osé contrevenir à ce pacte et courir vers lui malgré mon envie de le flairer, de le toucher, de le côtoyer. La lenteur de sa démarche cassait la cadence effrénée du quotidien. Il s’est dirigé vers les voitures stationnées en contrebas et s’est arrêté sans raison apparente au milieu du trottoir, les mains dans les poches de son manteau, le dos courbé, fixant le sol comme en proie à un oubli. Sa peine teintait l’air frais du printemps. Magnifiquement jaune, elle s’imprimait, radioactive, sur la surface de mes rétines. Cet homme-là errait, ne savait plus où il était, ne regardait plus devant lui. Un chagrin le dévorait. J’aurais voulu lui faire part de ma présence mais, vouant une adoration certaine à celle qui m’a intimé, de l’index, de l’attendre devant les portes de l’épicerie, je ne pouvais pas le rejoindre. Je me suis alors dressé et, dans mon désir de lui aboyer mon attention, j’ai donné naissance au vol des oiseaux. »
En outre, à chaque prise de « parole », le style épouse les caractéristiques propres à l’espèce qui témoigne. Haché, comme le vol du papillon ou sinueux, comme le déplacement du boa ; sans virgule pour reprendre sa respiration, pour le poisson rouge ; élaboré, pour le chimpanzé intelligent…
Ce choix narratif, qui n’a en soi rien de foncièrement révolutionnaire et qui aurait tout aussi pu n’être qu’un exercice de style, prend toute sa force ici dans ce qu’il permet à l’auteur de dire sur les protagonistes et, par extension, sur la race humaine.
« Les humains sont seuls. Malgré la pluie, malgré les animaux, malgré les fleuves et les arbres et le ciel et malgré le feu. Les humains restent au seuil. Ils ont reçu la pure verticalité en présent, et pourtant ils vont, leur existence durant, courbés sous un invisible poids. Quelque chose les affaisse. (…) Enfermés dans leur raison, la plupart ne franchiront jamais le pas de la déraison, sinon au prix d’une illumination qui les laissera fous et exsangues. Ils sont absorbés par ce qu’ils ont sous la main, et quand leurs mains sont vides, ils les posent sur leur visage et pleurent. Ils sont comme ça. »
« L’humain est un corridor étroit, il faut s’y engager pour espérer le rencontrer. Il faut avancer dans le noir, sentir les odeurs de tous les animaux morts, entendre les cris, les grincements de dents et les pleurs. Il faut marcher, enfoncer les pattes dans une bue de sang et remonter le long d’un fil d’or abandonné là par l’humain lui-même, lorsqu’il n’était qu’enfance et que nul toit ne scellait son plafond. Animal parmi les animaux, il ne souffrait pas encore. L’humain est un corridor et tout humain pleure son ciel disparu. Un chien sait cela et c’est pour cela que son affection pour l’humain est infinie. »
Rapprochant l’homme de l’animal, tout en évitant la facilité d’affubler les animaux de comportements humains factices, Mouawad montre que le plus bestial des deux n’est pas forcément la bête sauvage. Pour gagner en humanité, l’homme aurait beaucoup à apprendre de la nature et du règne animal :
« La plus banale des chauves-souris peut émettre plus de cent cris à la seconde. Chaque cri lui revient sous la forme d’un écho et chaque écho s’additionne à l’autre pour composer une échographie générale de l’espace qui lui permet de se repérer et de localiser dans l’obscurité n’importe quelle proie, n’importe quel prédateur.
– Pour voir… elles crient ?
– C’est en plein ça. Pour voir, elles crient. Alors je te pose une question : si la vie est un perpétuel cri de douleur, comment faire pour entendre son écho et échographier le visage de ce qui nous fait souffrir ?
– Si le cri est perpétuel, plus rien n’est visible.
– Bingo ! Chaque cri soit être suivi par un silence pour faire entendre son écho. Celui qui ne fait que hurler sa douleur n’en verra jamais le visage tout autant que celui qui s’obstine à la taire. C’est la leçon des chauves-souris : pour voir le visage de ce qui te fait souffrir, tu dois faire de ta douleur un collier qui enchaîne des perles de silence aux perles de tes cris. »
À l’image des Amérindiens, très marqués par leurs croyances ancestrales, qui tirent une bonne partie de leur sagesse de leur connaissance et de leur respect du monde animal.
« Donc. Réfléchis. Si un homme est un animal et que, suivant la croyance des Indiens, chaque humain a un animal comme symbole de cette part invisible de son être magique, sa poésie, son totem, pourquoi l’homme, en tant qu’animal, ne pourrait pas être cela pour son semblable en tant qu’humain ? Et si cela est possible, il existe une probabilité qu’un homme tuant un homme tue aussi son propre totem. Ou l’inverse : le totem tuant sa part humaine. »
Au-delà de sa seule forme narrative (à laquelle on l’a réduit un peu trop souvent à mon goût), Anima est un roman d’une richesse incroyable, de par ses différents niveaux de lecture. Tout s’y répond : le nom des personnages, à commencer par Wahhch lui-même ; le nom des villes américaines traversées qui en évoquent d’autres tout aussi emblématiques au Moyen-Orient (Carthage, Thebes, Cairo, Cabool, Lebanon…) ; la guerre de Sécession qui fait écho à la guerre du Liban ; les chevaux menés à l’abattoir résurgence de ceux enterrés dans les charniers ; sans oublier le titre du roman, Anima, qui renvoie à la fois à l’animal et à l’ “âme” latine…
Et à aucun moment cette forte charge symbolique n’est pesante mais, au contraire, toujours fait sens.
« Depuis la mort de Léonie à celle de Janice, depuis la parole de Coach à la fuite des chevaux, depuis la mort de Chuck à celle de Rooney, depuis les célébrations de la guerre de Sécession aux combats de chiens de Virgil et depuis le vol du pick-up abandonné près de Denver à la colère de Winona, tout était fidèlement rapporté, tout était réel et tout conduisait aux charognards de Tank Mountain. »
Aussi poétique qu’il est violent, aussi dérangeant qu’il est fascinant, Anima est un chant douloureux, éprouvant et obsédant.
Remarquable.
Le site web de l’auteur.
Le site Actes Sud propose un extrait d’Anima, lu par l’auteur, ainsi que des entretiens vidéos, auxquels j’ajoute le passage de Wajid Mouawad à La Grande Librairie.
* Sophocle, Les Intracrâniennes
Ce qu’ils en ont pensé
Hélène : « Porté par un style magnifique, tour à tour poétique et épique, Anima est un roman pluriel riche et profondément touchant. »
La Cause Littéraire : « Anima est « un roman initiatique et animiste foisonnant qui explore les effrayants abîmes de la conscience en même temps que l’être-au-monde de l’humanité ».
Les 8 Plumes : « Mouawad, très grand dramaturge, se révèle là immense écrivain. Ses histoires sont bouleversantes, son style emporte littéralement. »
Et sur Babelio.
Anima, de Wajdi Mouawad
Leméac/Actes Sud (2012) – 400 pages