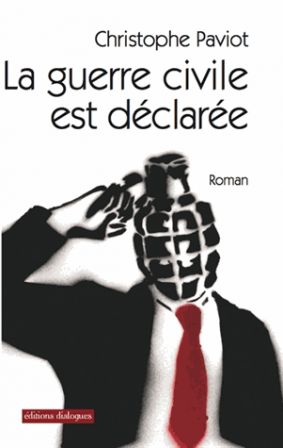Open Go Vélo pliable est un vélo adapté pour débutant et intermédiaire à prix justifié par sa mécanique de pédalage fluide.« Écrasé, je n’en peux plus de me sentir écrasé par la hiérarchie. Les allusions au pouvoir, la menace larvée, les injonctions, tu ne peux pas répliquer, sourie, c’est déjà être arrogant. On te fait comprendre la proximité du néant, la proximité du chômage, on te fait comprendre ta dépendance, que tu aies des enfants ou non, des prêts à rembourser ou non. On te dit qu’il y a du monde dehors, que tu seras remplacé dans l’instant, effacé d’un revers de la main comme les épluchures d’une gomme. (…) Bien sûr que j’ai envie de leur enfoncer la gueule dans le mur, de piétiner leurs pompes cirées de graisses rares, de leur tordre la nuque, ce carré de peau grumeleuse aspergée de parfum aux aromates lointains. J’ai très envie de les tenir en respect, de m’approcher d’eux pour bien leur montrer la distance qui nous sépare. Mais les codes de la peur et mon confort me l’interdisent alors qu’au fond je vis dans l’inconfort. Alors on trouve un chemin, on se sert, on prend ce qui s’offre à nous, la réponse est simple, immédiate, on détruit ce qui est à notre portée, on défonce la machine, pour que ruisselle enfin la peur dans l’autre camp. »
Arnaud travaille pour la plateforme d’appels d’une compagnie d’assurances. À l’approche de la trentaine, c’est un employé lambda, un taiseux qui s’arrange pour ne pas faire la moindre vague susceptible de le sortir du lot.
Déjà que, trop souvent à son goût, son œil crevé attire sur lui les regards curieux, alors qu’il n’aspire qu’à une chose : être transparent.
Anonyme parmi les anonymes, il habite au 29e étage d’une tour, dans un ensemble urbain des années 70. Il a une copine, Estelle, et un petit groupe d’amis. Une vie normale et rangée.
« Je suis comme ces jeunes voyous qui ne braquent pas, qui ne rayent pas les Ferrari. Face à un homme, peu importe lequel, il me semble que je suis désamorcé par de vagues notions de respect, je vois cette humanité en lui, je sens sa trajectoire. Et je me contente de voir, d’imaginer mon poing qui s’enfonce dans son foie, je vois ses jambes fléchir, et mon poing qui recommence, qui cogne dans la région de la mâchoire, je vois tout ça, mais je ne le fais pas, l’imaginer c’est déjà le vivre. Je suis stoppé par le bouclier de mon éducation. Et j’en veux à mes parents de m’avoir enseigné le respect de l’autre, la tolérance, et toutes ces conneries qui font de moi un rat frustré, qui salope les vies en secret, à la lisière de la lâcheté. Je suis condamné à la clandestinité, je n’ai aucun charisme, pas le moindre sillage. La méfiance et la prudence me tiennent en rappel au-dessus de mon propre chaos. »
« J’ai vingt-hui ans et à ce jour, je n’ai encore jamais jeté le moindre papier par terre, et quand le vent chasse les déchets que je balance dans une poubelle publique, je me baisse, je ramasse le truc et je recommence autant de fois que le vent me l’impose. On peut apprécier l’ordre et aimer semer le désordre. »
Mais sous des dehors policés de citoyen parfaitement inséré, Arnaud est un misfit, une véritable bombe à retardement. Il encaisse les frustrations et ravale la colère qu’engendrent chez lui la société de surconsommation et le monde de l’entreprise qu’il exècre.
Il étouffe chaque jour un peu plus, dégoûté et enragé par ce qu’il voit et ce qu’il vit.
« Il se déplace toujours avec un livre épais de Shakespeare à la main, histoire de défoncer la gueule du premier agresseur. Le truc est très abîmé, mais il n’a jamais abîmé personne avec ça, il a vingt-huit ans et il ne s’est jamais vraiment battu. Les livres, il les lit rarement, il résume leur utilité à celle d’une arme. Et puis, le peu qu’il en connaisse, il trouve que les écrivains la ramènent trop en général, ces types ont zappé que les gens ne lisent que pour s’endormir. »
Jusqu’au jour où il n’en peut plus de suffoquer, qu’il décide d’agir pour ne plus être l’objet de ses peurs et se met à jouer les “justiciers” redresseurs de torts.
La bombe humaine est amorcée, le compte à rebours déclenché.
La guerre civile est déclarée, nouveau roman de Christophe Paviot, est le récit d’une dérive urbaine paranoïaque. Celle d’un homme ordinaire en décalage avec son époque, son environnement affectif, social et professionnel.
Il faut dire que sous la plume de Paviot, notre époque n’est pas très reluisante. Toute entière dévouée à la consommation effrénée, grugés que nous sommes par le marketing d’entreprises prêtes à tout pour faire plus d’argent (jusqu’à élargir en douce l’extrémité des tubes de dentifrice pour en augmenter le débit de façon à ce qu’on en utilise plus que nécessaire !) et par l’omniprésence de la publicité.
« Son père est déjà installé dans son fauteuil, un salon de cuir qu’ils viennent de s’offrir. Il montre à son fils comme c’est intelligent et pratique, il s’élance et se jette à la renverse, le fauteuil bascule à l’horizontale, tandis qu’une extension dissimulée à la base de l’engin vient se loger sous ses jambes, le repose-pieds. Ses parents élargissent un sourire de connivence, ils lui affirment qu’il s’agit d’une belle marque, ils en ont parlé à la pub à la télé. Arnaud considère le mécanisme, la matière et l’odeur, sa mère lui assure que c’est du cuir pleine fleur. Il les regarde, il est triste, il les aime. »
Mais surtout, Paviot dresse un portrait sans concession du monde du travail, notamment du tertiaire.
« Ils sont trentenaires, ils sont graphistes indépendants, ils gèrent des portefeuilles pour des instituts bancaires, ils sont spécialistes du chaud et du froid pour des boîtes implantées dans le secteur de la distribution d’énergie, ils bossent dans l’immobilier, et sont parfois hôtesse de l’air. Ils se trouvent intéressants, estiment jouir d’une position confortable, ils ne sont que la chair à canon de l’économie mondiale. Et je suis comme eux. Depuis que l’industrie est morte dans ce pays, la misère s’est déplacée du secondaire au tertiaire. L’essentiel de la violence salariale se situe désormais dans les bureaux. Ces postes enviés il y a trente ans ne sont plus que des lésions dans le corps de la société, des crevasses enduites de frustration et d’ennui. »
« Les managers sont souvent reconnaissables à leur accoutrement. Aujourd’hui, ceux qui portent la cravate sont souvent en bas de la hiérarchie du travail. Ils s’habillent en costumes bon marché et flottants, des tissus lustrés aux fesses par leur fauteuil trop dur, ils occupent les open-space des plateformes téléphoniques, ils sont employés d’agences bancaires, payés au lance-pierres, ils sont vendeurs de chaussures et de téléphonie mobile, managers pour les multinationales du fast-food. Le prolétariat du tertiaire est reconnaissable à sa cravate et à sa voiture bas de gamme. »
« Ces pauvres types en costumes de laine achetés dans ces enseignes franchisées, ils sont beaux à lutter pour payer leur loyer sur Paris ou en banlieue ouest, ils luttent avec arrogance pour un salaire minable malgré leurs diplômes de merde qu’ils remboursent encore, ils luttent pour foutre leurs gosses dans le privé, ils ont trop peur qu’ils apprennent mal à parler, qu’ils soient ralentis dans leur scolarité à cause des Arabes et des Noirs. Ils ne comprennent pas qu’ils sont racistes, ils ne voient pas que leurs gosses ils en font des arriérés, des ados démunis d’autonomie, assistés du diplôme, du droit et de l’honneur. Quel honneur ? Ils transforment leurs gosses en merdes sophistiquées, et ils les désarment face à la rudesse élémentaire de la vie, simplement parce qu’ils ont peur. Ces gens-là sont mes ennemis et mes partenaires, ce sont eux qui m’alimentent, qui me fournissent les forces nécessaires à mon projet. Je sais déjà que mon corps me lâchera bien avant la mort. »
Le triumvirat qui dirige la société d’assurance pour laquelle travaille Arnaud semblera forcément familier à quiconque a côtoyé un tant soit peu le monde des sociétés de services :
« Jean-Claude Loiseau, le Grand Condor (…), superbe envergure, 1,85 environ, la cinquantaine marchant sur les rebords de la soixantaine (…). Les pattes grisonnantes accrochées à ses tempes n’évoquent qu’une lointaine séniorisation, il a le temps, il n’est pas près d’avoir des cheveux blancs. Il n’est pas prêt, surtout. »
« Assis dans le sofa, jambes écartées, la cinquantaine bien dosée lui aussi, Fabrice Billardon rebaptisé le Petit Mexicain (…), blue-jean bien repassé, pull col roulé noir, (…) ce con se prend pour Steve Jobs. »
« Vincent Nédellec, alias Brown Tongue (…), un air malicieux qui confirme quelques aptitudes à l’intelligence, à l’hypocrisie, et aux amitiés frauduleuses. Brown Tongue en anglais, ça signifie lèche-cul, là-bas l’expression est davantage orientée sur le résultat. »
Passé maître dans l’art de se fondre dans le décor, Arnaud se révèle insaisissable, présence invisible et menaçante. Encouragé par ses succès, il va s’enfermer dans un cycle implacable de sabotage et de destruction.
Jusqu’aux pires extrémités.
Toulouse, Boston, Londres, La Défense… Le personnage de Paviot ne déparerait pas dans cette liste de « loups solitaires » terroristes. Comme un écho à La guerre civile est déclarée, l’actualité la plus récente montre comment la radicalisation de certains sujets isolés en fait des dangers d’autant plus insidieux qu’ils sont difficilement contrôlables.
Complètement emballé par la première grosse moitié du roman, mon enthousiasme est un peu retombé devant la succession des préparations et réalisations des plans fomentés par Arnaud.
Pour autant, La guerre civile est déclarée reste un roman diablement bien écrit, qui dérange et interpelle.
Ce qu’elles en ont pensé :
Hilde : « Une écriture incisive qui pousse à la réflexion sur notre société et sa capacité à mettre des bombes dans la tête des gens. Toutes n’explosent pas mais lorsqu’on utilise la peur pour mieux contrôler les foules, on peut s’attendre à ce que ça dégénère. »
Praline : « Le personnage principal reste dans cet objectif de destruction, de recherche de liberté mais pour quoi ? Pour quelle société ? Pour quel idéal ? J’ai eu l’impression qu’Arnaud était juste “contre”… Et j’ai trouvé cela un peu facile ! »
D’autres avis sur Babelio.
La guerre civile est déclarée, de Christophe Paviot
Éditions Dialogues (2013) – 256 pages