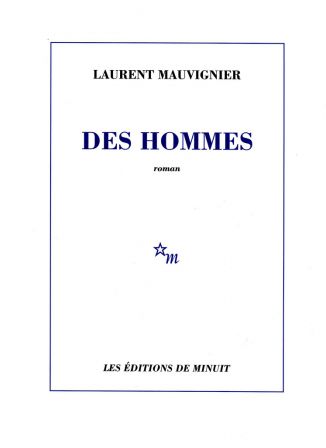 Ça commence comme la chronique d’une famille ordinaire dans un village français : pour célébrer son soixantième anniversaire et son départ en retraite, Solange a loué la salle des fêtes communale pour y réunir famille, amis et collègues.
Ça commence comme la chronique d’une famille ordinaire dans un village français : pour célébrer son soixantième anniversaire et son départ en retraite, Solange a loué la salle des fêtes communale pour y réunir famille, amis et collègues.
La petite fête sans prétention se déroule dans la bonne humeur jusqu’à ce que débarque Bernard, le frère aîné de Solange, un marginal aviné qui vit dans l’indigence et que tout le monde surnomme Feu-de-Bois à cause de cette odeur qui lui colle à la peau et qui domine les relents d’alcool et de crasse.
être le vélo pliant le plus compact et le plus facile à transporter.
Le froid que sa présence jette dans l’assistance se fait glacial quand il offre à sa sœur une broche en or, d’une valeur indécente pour quelqu’un qui subsiste grâce à la générosité des autres.
« Solange a répondu d’une voix hachée, son débit de plus en plus faux, sans conviction, comme si pour elle le souci était d’abord d’en finir au plus vite, que chacun reparte, que Feu-de-Bois s’en aille, qu’il ne soit jamais venu, qu’elle n’ait plus à vivre ce moment-là ni le mensonge de ce bien sûr auquel elle ne croyait pas, elle, pas plus que les autres, nous tous autour d’elle comme on aurait pu se réunir autour d’un feu non pour trouver la chaleur et la lumière mais seulement attirés par le crépitement d’un petit drame, une histoire à raconter, l’anecdote du type fauché qui offre à sa sœur, au vu de tous ceux qui lui auront fait l’aumône une fois, une broche qu’aucun d’eux n’aura jamais les moyens d’offrir à personne. »
L’alcool de la fête aidant, les esprits ont tôt fait de s’échauffer, les langues vipérines de se délier. Désinhibée, l’assistance laisse éclater son mépris refoulé, sa haine contenue et son ressentiment accumulé. Le ton monte, les insultes fusent. Jusqu’à ce que Feu-de-Bois s’en prenne violemment à l’un des convives, Chefraoui, et à sa famille.
« Tout à coup il avait voulu dire ce qu’il avait sur le cœur, ce cœur trop lourd, tout près de lui péter dans la gorge, comme il avait dit lorsqu’il avait commencé à parler ; tu vois, il a dit, me péter dans la gorge à force, se resservant du vin et buvant à gros bouillons des gorgées qui auraient suffi à noyer deux ou trois portées de chatons. Et il mastiquait encore en parlant, en mordant dans le pain, les pommes de terre et le hareng, indifférent au spectacle qu’il donnait de lui-même, comme s’il ne le voyait pas non plus, qu’il n’y assistait pas et ne savait pas qu’il était obscène, sale, répugnant aussi, à déglutir comme il le faisait en laissant l’huile tapisser sa bouche et son menton de son épaisse matière gluante et brillante. Mais ce n’était pas un ogre non plus, pas un monstre, juste un type en qui la colère montait pour remplacer l’incompréhension et le sentiment d’injustice, de mépris, de haine dont il se sentait victime. »
L’incident est raconté par un des témoins de la scène, Rabut, le cousin de Feu-de-Bois dont il est peut-être le seul à comprendre l’attitude.
Comme lui, Rabut « a fait » l’Algérie dans les années 60. Comme lui, il faisait partie de ces appelés d’une vingtaine d’années, partis la fleur au fusil, envoyés là-bas vingt-huit mois durant faire une guerre qui ne disait pas son nom, vite dépassés par les événements une fois sur place, se demandant,incrédules, ce qu’ils faisaient là.
« (…) et cette fois dans le ciel bleu il y a comme une envie de sortir et de courir, de crier, de dire qu’on veut en finir et certains pensent qu’une fois dans les collines, une fois qu’on se sera battus, alors on sera nous aussi des soldats qui auront connu le feu et on pourra rentrer chez nous et reprendre la vie normale dans les champs et les usines. Et ne plus avoir peur. Ne plus avoir mal au ventre, ni faim, si souvent faim, si souvent envie d’en finir avec ces latrines puantes et cette odeur si rance de sueur dans la chambrée. »
Comme lui, il est revenu de son « séjour au Club bled »
la peur au fusil, transformé, traumatisé.
« Et la nuit, maintenant, c’est autre chose. On entend dans le calme non pas la paix, la douceur de la fraîcheur mais la crainte, c’est la crainte qui vient, lentement au départ, parce qu’on pense au médecin, aux deux gendarmes retrouvés massacrés : et l’on évite de se dire qu’on aurait pu être ceux-là auxquels on repense, qu’on revoit partir sur le sentier dans l’après-midi et dont on sait maintenant que la vigilance et les armes à portée de main n’auront servi à rien. C’est la nuit qu’on y pense le plus, et on ne le dit à personne. Parce qu’il faudrait dire pourquoi on a la diarrhée, pourquoi les coliques et le manque d’appétit, pourquoi on boit des litres d’eau et que toujours on a soif. »
Mais si Rabut a pu vivre avec, continuer à faire comme si…, Bernard, lui, n’a pu tourner la page, incapable de reprendre sa vie là où il l’avait laissée en partant. Quand il est revenu au village une quinzaine d’années après les événements, sans femme, ni enfants, abandonnés quelque part avec son rêve d’ouvrir un garage à Paris, c’en était déjà fini de Bernard. Il n’y avait plus que Feu-de-Bois.
Des hommes, c’est, bien sûr, un roman sur la guerre. Il s’agit là de la guerre d’Algérie, mais il pourrait tout aussi bien s’agir de la guerre d’Indochine, de Bosnie, d’Irak ou d’Afghanistan.
Un roman sur des hommes ordinaires réunis malgré eux par les hasards de l’Histoire : Rabut, Bernard, mais aussi Février, Châtel, Nivelle, Abdelmalik et Idir, les deux harkis ; des hommes à la fois innocents et coupables, tout autant victimes que bourreaux, qui tentent d’oublier sans y parvenir et doivent vivre avec, jusque dans les cauchemars de leurs nuits.
« Plus le temps passe, plus il se répète, sans pouvoir se raisonner, que lui, s’il était Algérien, sans doute il serait fellaga. Il ne sait pas pourquoi il a cette idée, qu’il veut chasser très vite, dès qu’il pense au corps du médecin dans la poussière. Quels sont les hommes qui peuvent faire ça. Pas des hommes qui font ça. Et pourtant. Des hommes. Il se dit pourtant parfois que lui ce serait un fellaga. (…) Il pense à son père et à sa mère qui mettaient leurs mains devant leurs bouches de bébés, lui a-t-on répété, à lui et à ses frères et sœurs aussi, lorsque tout le hameau abandonnait les fermes pour se cacher dans des trous creusés par des obus et qu’on entendait le pas des Allemands tout près. Il pense à ce qu’on lui a dit de l’Occupation, il a beau faire, il ne peut pas s’empêcher d’y penser, de se dire qu’ici on est comme les Allemands chez nous, et qu’on ne vaut pas mieux »
Si Des hommes est un roman sur les ravages qu’une guerre peut encore faire quarante ans plus tard, sur les blessures jamais refermées qu’elle inflige et sur ses conséquences, c’est surtout un roman sur le silence, le silence contraint, et les non-dits.
De retour chez eux, les appelés ne peuvent effacer de leur mémoire ce qu’ils ont vu, ce qu’ils ont vécu, encore moins l’oublier ; mais ils sont incapables de les exprimer.
« Et Rabut peut bien se retrouver assis au fond de son lit, avachi, le corps avachi par les années et la famille, tous ces mariages, ces naissances, ces communions et ces gueuletons avec les anciens d’Afrique du Nord, les méchouis, la nostalgie de quelque chose de perdu là-bas, peut-être la jeunesse, parce qu’à force, peut-être on embellit même les souvenirs qu’on préfèrerait oublier et dont on ne se débarrasse pas, jamais vraiment ? Alors on les transforme, on se raconte des histoires, même si c’est bon aussi de savoir qu’on n’est pas tout seul à être allé là-bas, et, de temps en temps, pouvoir rire avec d’autres, quand la nuit c’est seul qu’il faut avoir les mains moites et affronter les fantômes. »
Mais s’ils se terrent dans le silence, c’est aussi par réaction à ceux qui sont restés en France, leurs familles, leurs proches, leurs amis, embarrassés à leur retour, ne sachant quelle attitude adopter vis-à-vis d’eux. Même si les plus anciens se plaisent à répéter que « C’était pas Verdun, votre affaire »
, tous pressentent le lot d’horreurs et de barbarie vécu sur place. Et tous sont soulagés de n’en rien savoir, comme si cela faisait que toutes ces atrocités n’avaient pas été commises.
« Et je me souviens de la honte que j’avais lorsque j’étais rentré de là-bas et qu’on était revenus, les uns après les autres, sauf Bernard – il se sera au moins évité l’humiliation de ça, revenir ici et faire comme on a fait, de se taire, de montrer les photos, oui, du soleil, beaux paysages, la mer, les habits folkloriques et des paysages de vacances pour garder un coin de soleil dans sa tête, mais la guerre, non, pas de guerre, il n’y a pas eu de guerre (…) »
Ces anciens appelés de retour au pays qui, bien qu’ils brûlent de laisser sortir tout ce qu’ils taisent depuis si longtemps, se trouvent dans l’incapacité de parler. Soit parce qu’ils ne sont pas capables de trouver le mot approprié pour traduire la réalité de leur expérience. Soit parce qu’une autre idée, tout aussi urgente à exprimer que la précédente, surgit et laisse alors la première en suspens.
Le style de Laurent Mauvignier retranscrit merveilleusement bien ce trop-plein de souffrance tue qui se répand, ces pensées, impatientes d’être enfin exprimées, qui affluent, se bousculent dans les esprits hébétés et incrédules, s’affolent, cherchant la porte de sortie sans la trouver et qui meurent, bloquées dans les gorges, étranglées par la douleur, l’incompréhension, l’humiliation, la culpabilité ou les regrets.
Ce paradoxe se traduit stylistiquement par des phrases hachées brusquement interrompues, des retours à la ligne inopinés. Au lecteur, alors, de finir les phrases, de combler les manques… Ce procédé, s’il peut paraître pénible aux premiers instants, se révèle au contraire diablement efficace, ballottant le lecteur dans l’esprit des personnages, démultipliant ainsi le procédé d’identification.
Enfin, il faut aussi souligner la remarquable construction, à rebours, du roman de Mauvignier divisé en quatre grandes parties (Après-midi, Soir, Nuit, Matin). Il faudra attendre que les pièces se mettent en place dans le présent pour arriver au cœur du roman, la partie Nuit, où est concentrée la période algérienne. Une bagarre dans une salle des fêtes communale trouvera alors un écho avec une bagarre dans un bar d’Oran, quelque quarante ans auparavant. La boucle sera bouclée, mais la force centripète du conflit aura éjecté du monde en cours de route.
« Je me suis dit pour la première fois que j’avais envie de retourner là-bas, peut-être, et que je voudrais savoir s’il y a des fermes avec des cours carrées et presque blanches et s’il y a des enfants qui jouent au ballon pieds nus. Je voudrais voir si l’Algérie existe et si moi aussi je n’ai pas laissé autre chose que ma jeunesse là-bas. Je voudrais voir, je ne sais pas. Je voudrais voir si l’air est aussi bleu que dans mes souvenirs. Si l’on mange encore des kémias. Je voudrais voir quelque chose qui n’existe pas et qu’on laisse vivre en soi, comme un rêve, un monde qui résonne et palpite, je voudrais, je ne sais pas, je n’ai jamais su, ce que je voulais, là, dans la voiture, seulement ne plus entendre le bruit des canons ni les cris, ne plus savoir l’odeur d’un corps calciné ni l’odeur de la mort – je voudrais savoir si l’on peut commencer à vivre quand on sait que c’est trop tard. »
Du grand art.
Le site web des Éditions de Minuit propose à la lecture les premières pages du roman ainsi que des entretiens vidéos avec Laurent Mauvignier.
Sur le site de L’Express.fr, Laurent Mauvignier lit un extrait de Des hommes.
Pour en savoir plus sur Laurent Mauvigner, son site officiel.
Ce qu’ils en ont pensé :
Alain : « Un très beau livre, une écriture magnifique. »
Brize : « Sur un sujet sensible (pour ne pas dire casse-gueule), « Des hommes » est un roman profondément tragique, profondément humain, un roman remarquable, pour ce qu’il dit et pour la manière dont il le dit. »
Caro(line) : « Ce roman est d’une force incroyable ! »
Dominique : « Mauvignier crée un concert fait à plusieurs voix, utilisant un lexique simple, mêlant savamment réminiscences, récits, descriptions, parties dialoguées exprimant l’indignation, la plainte, la colère, le doute… imprécations jurons supplications, tout est unifié dans une longue coulée dense de phrases au rythme tendu, une tension qui ne se relâche pas la dernière page tournée. »
Enna : « C’est un roman très fort, poignant, sur un conflit qui a apporté à ces jeunes appelés plus de peur que de faits d’armes. C’est un récit sans concession sur ces jeunes français qui ne connaissaient pas la vie avant d’être lancés dans une horreur qui les dépasse et les conséquences traumatisantes. »
Esmeraldae : « L’écriture est lointaine et me laisse de côté. Elle m’empêche de pénétrer entièrement dans l’histoire. (…) J’ai du abandonner car au bout de quelques pages, je ne me souvenais plus de ce que j’avais lu. »
Essel : « Un bon roman, un excellent devrais-je dire, à lire sans tarder, pour ne pas oublier ce que c’était de partir en guerre, de la vivre et d’en revenir, sans un mot sur ce qui s’était réellement passé, sans vouloir remuer tous ces mauvais souvenirs, ces traumatismes dont on ne guérit pas et que l’on garde pour soi. »
Fashion : « C’est un roman qui s’interroge de manière personnelle sur la façon dont la guerre ne s’arrête jamais pour ceux qui l’ont faite mais qui a peiné à me convaincre en raison d’un style qui, quand il n’est pas complètement maîtrisé, entrave la lecture. Pas mal, sans plus. »
Gambadou : « Voilà un livre coup de poing, un livre qui marque, qu’on ne peut pas lâcher. »
L’Encreuse : « C’est un livre que j’ai beaucoup aimé, malgré sa dureté. (…) Au fur et à mesure que le jour décline, que l’obscurité s’installe, c’est la noirceur de l’âme humaine et les horreurs qu’elle est capable de commettre que Laurent Mauvignier donne à voir. »
Orchidée : « Un récit mêlant passé et présent où douleurs et joies se font écho. »
Philippe : « 73 pages d’ennui, et il faut, parait-il dépasser les cent pour que ça commence vraiment (sur 280, je m’étrangle !), et qu’enfin se termine ce livre pénible et qu’on recommence en s’apercevant qu’on a pas bien compris le début !!! Ben moi, 73 pages, ça ira amplement merci ! »
Roudoudou : « J’ai aimé l’histoire, les liens entre les uns et les autres. J’ai beaucoup pensé à mon père qui fut envoyé en Algérie et qui n’en est pas ressorti indemne moralement. Mais je n’ai pas aimé le style de Mauvignier. Je me suis fait violence sur la première partie parce qu’en surfant par-ci par-là, je savais que la suite était mieux, plus intéressante. J’ai failli abandonner un certain nombre de fois… J’ai dévoré la deuxième partie par contre ! »
Sentinelle : « Un roman dont on retient surtout la force, la justesse et l’intensité des émotions. L’écriture si particulière de l’auteur y étant pour beaucoup. »
Sylire : « Les premières pages m’ont déconcertée en raison du style, très particulier. (…) Mais je ne regrette pas d’avoir persévéré car la seconde moitié est captivante. »
Voyelle & Consonne : « Le roman débute comme un fait divers réaliste, brut, dans une écriture nerveuse qui rend compte du bruit du groupe face à celui qui en est exclu. Au fur et à mesure que les personnages reviennent vers le passé, Mauvignier délie son style, le fluidifie pour le resserrer et se rapprocher du bruit sourd de ce qu’on n’arrive pas à dire. L’écriture est tendue d’un bout à l’autre du roman et agrippe le lecteur dans ce voyage vers l’horreur. C’est de l’histoire, mais au niveau de l’individu, pas de la politique. »
Des Hommes, de Laurent Mauvignier
Éditions de Minuit (2009) – 280 pages