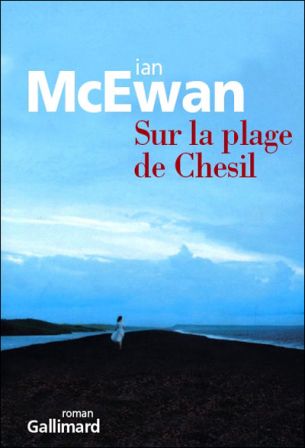 Florence et Edward sont jeunes et viennent de se marier. Les festivités passées, ils se retrouvent seuls, en tête à tête pour leur nuit de noces, dans cet hôtel du Dorset, au bord de la plage de Chesil.
Florence et Edward sont jeunes et viennent de se marier. Les festivités passées, ils se retrouvent seuls, en tête à tête pour leur nuit de noces, dans cet hôtel du Dorset, au bord de la plage de Chesil.
Passons maintenant aux vélos pliants de luxe, ces vélos sont super légers et vraiment pratique à transporter tout en proposant des systèmes de pliage parmi les plus élaborés du marché.
Ce pourrait être le début d’une jolie romance de tous les jours, sauf que Ian McEwan en a décidé autrement en choisissant deux personnages « jeunes, instruits, tous les deux vierges avant leur nuit de noces »
qu’il plonge dans l’Angleterre pudibonde des swingin’ sixties, cette « époque où le fait d’être jeune représentait un handicap social, une preuve d’insignifiance, une maladie vaguement honteuse dont le mariage était le premier remède »
, « des temps où parler de ses problèmes sexuels était manifestement impossible. »
Florence et Edward se sont rencontrés par hasard, à l’occasion d’un meeting pour le désarmement nucléaire à Oxford. D’ailleurs, « Plus tard, c’est ce qui les fascinerait le plus : que leur rencontre n’ait tenu qu’à un fil. »
Ils sont les purs produits de deux milieux sociaux opposés : elle, violoniste dans le Quatuor Ennismore, appartient à une famille aisée ; lui, issu d’une famille plus modeste et plus tourmentée (sa mère Marjorie est “mentalement dérangée”), vient de terminer ses études d’histoire et préfère le blues à la musique classique.
En cette soirée capitale, complètement seuls, tous deux n’ont qu’une obsession : être à la hauteur au “moment crucial” qu’Edward attend avec excitation et impatience, tandis que Florence envisage le passage à l’acte avec dégoût et l’entrain d’un mouton qu’on même à l’abattoir.
« Sans qu’il se l’avoue vraiment, la réserve de Florence s’accordait bien avec sa propre ignorance et son manque d’assurance ; une femme plus exigeante et sensuelle, plus « libérée », aurait pu le terrifier. »
Il s’en faudra d’un tout petit rien pour que la lune de miel tourne à la lune de fiel. Et « Voilà comment on peut changer radicalement le cours d’une vie : en ne faisant rien.
»
Hôtel de la plage. Deux jeunes amoureux, une nuit de noces, un hôtel en bord de mer, l’Angleterre des années 60. Voilà les ingrédients du dernier Ian McEwan, Sur la plage de Chesil, chronique douce amère d’une catastrophe annoncée.
L’auteur fait alterner les voix intérieures des deux protagonistes. Deux voix, deux points de vue qui permettent au lecteur de se placer au-dessus de la tempête, de mesurer l’écart qui existe entre les actes et les pensées profondes des deux jeunes mariés, et d’assister à l’inévitable désastre.
Car, si Florence et Edward sont sincères, ils n’ont pas conscience de ce carcan socioculturel qui les étouffe, les empêche de se confier, de pallier leur inexpérience. On est en droit de se demander s’ils sont réellement amoureux ou s’ils sont amoureux d’une représentation de l’amour dictée par les conventions de leur époque et de leur classe sociale. D’ailleurs, que savent-ils de l’amour ? Et finalement, se connaissent-ils vraiment ? « Qu’est-ce qui les arrêtait donc ? Leur personnalité et leur passé, leur ignorance et leur peur, leur timidité, leur pruderie, leur manque d’aisance, d’expérience ou de naturel, vestiges des interdits religieux, leur anglicité, leur classe sociale, et même le poids de l’Histoire. Trois fois rien.
»
Mais là où McEwan est très fort, c’est que Sur la plage de Chesil n’est pas que le génial roman d’une love story ratée entre deux puceaux de l’Angleterre puritaine des années 60. Bien que planté dans une époque et un pays bien marqués, son propos est universel : celui des frustrations nées des incompréhensions et des non-dits, de l’absence de dialogue et de ses conséquences sur les vies respectives de deux êtres, quels qu’ils soient, où et à quelque époque ils vivent.
De son écriture fine, il décortique au scalpel les sentiments et les troubles amoureux, tantôt avec délicatesse, tantôt avec plus de crudité, mais sans jamais se départir d’une pointe d’ironie.
« Entre Edward et Florence, rien n’allait vite. Les avancées importantes, la permission qu’elle lui donnait en silence d’aller plus loin dans ce qu’il avait le droit de voir ou de caresser, ne s’obtenaient que graduellement. Le jour d’octobre où il entrevit pour la première fois ses seins nus précéda de plusieurs semaines le moment où il put les toucher – le 19 décembre. Il les embrassa en février, mais pas les pointes, que ses lèvres n’effleurèrent qu’une seule fois en mai. Elle-même ne s’autorisait à explorer son corps à lui qu’avec une prudence plus grande encore. Une initiative improvisée, une suggestion osée pouvaient ruiner des mois d’efforts. Ce fameux soir au cinéma, lors de la projection d’Un goût de miel, où il lui avait pris la main pour la plonger entre ses cuisses, les ramena plusieurs semaines en arrière. »
En outre, l’insertion de flash back retarde habilement la crise finale et fait monter la tension jusqu’à son paroxysme sur la plage.
Sur la plage de Chesil est un petit bijou de concision qui m’a réconcilié avec McEwan (dont j’avais aimé Expiation mais pas Délire d’amour), et cela malgré une fin trop vite expédiée à mon goût. (Attention spoiler : il m’a d’ailleurs semblé douteux qu’à cette époque, dans le milieu social de Florence, ils puissent avoir divorcé aussi facilement et aussi rapidement).
A la liste quasi exhaustive des billets sur ce roman disponible sur le Blog-O-Book, j’ajoute les billets de Thom et de L’encreuse.
Sur la plage de Chesil, de Ian McEwan
Traduit de l’anglais par France Camus-Pichon
Gallimard – Du monde entier (2008) – 149 pages