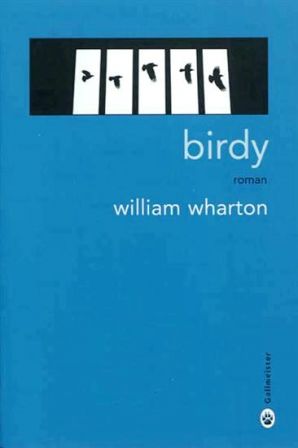 Philadelphie 1942.
Philadelphie 1942.
Tout juste sorti de l’hôpital où il a subi une greffe du visage après que l’explosion d’un obus l’a laissé défiguré, Alphonso Columbato est appelé au chevet de son ami d’enfance, Birdy.
Depuis sa démobilisation, Birdy est confiné au service psychiatrique d’un hôpital militaire. Barricadé dans son mutisme, il reste prostré dans sa cellule comme dans une cage, la plupart du temps en position accroupie, et refuse de se nourrir à moins qu’on lui donne la becquée. Parfois, il se met à sautiller ou à battre des bras comme s’ils étaient des ailes.
« J’essaie de le regarder. Il est à moins de deux pas de moi. Mais c’est comme de regarder dans les yeux d’un chien ou d’un bébé. Au bout d’un moment, on ne peut plus continuer parce qu’on sait qu’on leur fait mal à leur brûler des trous dans l’âme. Ils n’en savent pas assez pour détourner la tête, mais ils ont peur. Je regarde ailleurs. »
Les vélos pliants sont multiples et variés.
Le psychiatre espère que la présence d’Al agira sur Birdy comme un électrochoc qui le ramènera à la réalité.
Désarmé face au comportement de son ami, Al essaie de casser la glace en engageant la conversation, et passe en revue les grands moments qui ont jalonné leur invraisemblable amitié.
« On est trop proches, Birdy, on est trop quelque chose l’un pour l’autre. »
Car bien que tous les deux soient issus d’un milieu modeste, rien ne prédestinait ces deux gamins de la banlieue de Philadelphie à devenir les inséparables amis qu’ils sont devenus.
Fils d’émigrés italiens, Al est une grande gueule au sang chaud, un bagarreur qui aime autant jouer les gros bras que baratiner les filles. Birdy, lui, est tout le contraire : gringalet rêveur, il ignore ses congénères et ne se passionne que pour les oiseaux. Son obsession : voler, comme eux. Une obsession qui, à l’adolescence, confinera à la folie et aura raison de son amitié avec Al.
« Je commence même à me demander si notre proximité à Birdy et à moi, toutes ces années, n’était pas un peu suspecte. De tous les gens que j’ai connus, personne n’avait un ami aussi proche. C’était presque comme si on était mariés. Un club privé pour deux. De treize à dix-sept ans, j’ai passé plus de temps avec Birdy qu’avec tous les autres réunis. D’accord, je draguais les filles et Birdy jouait avec ses oiseaux, mais c’est la seule personne dont je me sois senti proche. On disait de nous qu’on avait les mêmes intonations de voix, et on sortait souvent les mêmes phrases exactement au même moment. Birdy me manque. Il faut qu’il revienne pour que je puisse lui parler. J’en ai besoin. »
Le roman alterne les voix d’Al et de Birdy. Tandis qu’il égrène ses souvenirs d’enfance, Al interpelle Birdy sans succès et s’interroge sur l’état mental et le comportement de son ami.
« Le problème, c’est que je ne suis pas tellement sûr d’avoir envie que Birdy revienne à la réalité. Le monde est si pourri. Plus j’en vois, plus ça me débecte. Birdy sait probablement ce qu’il fait. Il n’a plus besoin de se soucier de rien, il y aura toujours quelqu’un pour s’occuper de lui, pour le faire manger. Il peut passer tout le reste de sa vie à faire semblant d’être un canari. Qu’est-ce qu’il y a de si mal à ça ?
Bon Dieu, j’aimerais bien me trouver une bonne folie moi aussi. Peut-être que je pourrais jouer au gorille, comme le gars de l’autre côté du couloir ; juste chier dans ma main de temps à autre et le balancer sur quelqu’un. Ils m’enfermeraient et s’occuperaient de moi comme ils l’ont fait à l’hôpital à Metz. Oui, je serais capable de le faire. Ça veut peut-être dire que je suis fou. Tout ce que je sais, c’est que c’est pas si mal quand on laisse un autre prendre toutes les décisions. »
Dans ce semblant de dialogue sans répondant, affleurent aussi les traumatismes de la guerre. Profondément affecté, Al n’est plus la tête brûlée qu’il était en partant au front.
« Mon Dieu, ce serait bien ! Juste laisser aller, arrêter de faire semblant, laisser tout sortir, hurler, gueuler comme tarzan, escalader les murs ou les renverser, cracher ou pisser ou chier sur tous ceux qui approchent. Mon Dieu, ce serait bon ! Qu’est-ce qui m’en empêche ? On m’a fait assez de mal. Je pourrais le faire si j’en avais vraiment envie. Personne ne pourrait m’en vouloir. »
Pendant ce temps, sourd aux sollicitations d’Al, Birdy est plongé dans un monologue intérieur onirique, à la limite de la folie, exclusivement peuplé d’oiseaux.
« Quand il se laisse tomber du perchoir le plus haut, il replie ses ailes le long de son corps et ne les ouvre que juste avant de toucher le sol. J’ai l’impression que même si on lui enlevait toutes les plumes des ailes, il volerait encore. Il vole parce qu’il n’a pas peur et non pas parce que c’est une chose que les oiseaux sont censés faire. Son vol est un acte de création personnelle, un défi. »
Jusqu’à ce que je lise ce roman, Birdy était pour moi un sublime film d’Alan Parker, Grand prix du Jury au festival de Cannes en 1985 que j’ai vu (et même revu) dans mon adolescence. Outre certaines séquences « choc », je garde aussi en mémoire la bande-son hallucinatoire de Peter Gabriel aux percussions hypnotiques.
J’ignorais que, comme souvent, ce film était adapté d’un roman. En l’occurrence un roman de William Wharton, pseudonyme choisi par Albert William Du Aime (sous lequel certains critiques soupçonnaient à tort Sallinger de se cacher).
Des dizaines d’années après le film, j’ai aimé revivre cette amitié singulière grâce au livre. J’en ai éprouvé un plaisir renouvelé mais différent, ne serait-ce que parce que Parker a transposé l’action de l’époque de la seconde guerre mondiale à celle de la guerre du Vietnam. Si en fin de compte ça ne change pas grand-chose à la portée du roman, ce contexte l’inscrit tout de même dans une toute autre ambiance.
Autre variante entre les images et les mots, de taille celle-là : alors que j’avais gardé du film l’image d’un Birdy troublant (Matthew Modine y serait-il pour quelque chose ?), j’ai refermé le roman avec une nette préférence pour Al, touchant de vulnérabilité, loin du personnage solide et frondeur dont j’avais souvenir.
Les retrouvailles de ces deux hommes, si dissemblables, réunis et réconciliés par les aléas de la vie, cette amitié viscérale et indestructible qui va leur permettre de surmonter ensemble les traumatismes psychologiques liés à la guerre, sont bouleversantes.
Outre l’amitié et la guerre, Birdy brasse également avec maestria les thématiques de l’enfance, de la liberté, du racisme, de la folie…
« On a tous nos folies personnelles, privées. Si ça arrange suffisamment les gens, on te déclare fou. Parfois, toi-même tu n’en peux plus, alors tu racontes à quelqu’un que tu es fou, et ils consentent à s’occuper de toi. »
« On est dingues parce qu’on ne peut pas accepter l’idée que les choses arrivent sans raison et qu’elles ne veulent rien dire. On n’arrive pas à voir la vie comme une longue série de haies qu’il faut qu’on saute d’une manière ou d’une autre. Il me semble que tous ceux qui ne sont pas fous passent leur vie à tailler ces haies pour pouvoir passer. Ils vivent ça jour après jour, parce que chaque jour est là. Et puis, quand il ne leur reste plus de jours, ils ferment les yeux et disent qu’ils sont morts. »
Au-delà du style, la structure narrative rythmée alterne les voix d’Al et Birdy et les allers-retours entre passé et présent.
Birdy est un roman qui prend aux tripes et qui, l’air de rien, marque durablement son lecteur. D’ailleurs, Birdy n’était-il pas en lice pour le Pulitzer en 1980, aux côtés du Chant du bourreau, de Norman Mailer et du Ghost writer, de Philip Roth ? Si c’est Mailer qui rafle la distinction suprême cette année-là, Wharton recevra, lui, le National Book Award 1980 dans la catégorie premier roman.
Alors ne vous dispensez pas de cette lecture poignante sous prétexte que vous avez déjà vu le film d’Alan Parker, et que vous connaissez l’histoire (avant de vous installer dans votre fauteuil, devant Titanic, vous ne connaissiez pas l’histoire, peut-être ?). Les auteurs qui parviennent à captiver leur lecteur pour l’ornithologie et à rendre crédible (et, plus fort encore, pas du tout risible) une relation troublante et quasi sexuelle entre un homme et une femelle canari, ne courent pas les rues.
P.S. : Ne passez pas non plus à côté de la postface du fils de l’auteur, riche d’enseignements sur la genèse du roman et de ses ramifications intimes avec la vie de son auteur.
Les premières pages du roman sur le site des éditions Gallmeister.
Ce qu’ils en ont pensé :
Alexandre – La Cause Littéraire : « Birdy est un livre étrange et singulier. Ce texte est dense. Fort pour celui qui entre en empathie avec Al et Birdy. Ce texte peut vous soulever. »
Bernard Quiriny : « Construit avec maestria (flash-backs et alternance entre Al et Birdy), Birdy n’a rien perdu de sa force. Au-delà de ses thèmes classiques, bien transportés à l’écran par Parker (l’amitié, la liberté et le trauma de la guerre), il époustoufle par son style direct à la John Fante et par des scènes clés d’une rare intensité. »
Le Combat Oculaire : « C’est tout en métaphore, avec autant de poésie que de cruauté, autant d’enfermement que de sentiment de liberté. A savoir en plus que c’est tiré d’une histoire vraie, presque autobiographique, et que le ressenti y est puissant. »
Liliwenn : « Un livre qui coupe le souffle… »
Mimi Pinson : « C’est la construction, un peu particulière qui donne à ce roman tout son cachet. »
Philémont : « Sans temps morts, mais avec un sens évident de la dramaturgie, William Wharton a réalisé avec Birdy un formidable roman sur l’amitié, la liberté, l’horreur de la guerre et finalement le sens de la vie. Il fait partie de ces œuvres qui, sans ostentation, deviennent inoubliables dès lors que l’on a pris le temps de la découvrir. »
Tête de Ganache : « La narration est fantastique. D’un chapitre à l’autre nous rentrons dans la tête de l’un ou de l’autre des personnages. On va comprendre ce qui s’est passé pour chacun d’eux et comment ils en sont arrivés là. »
D’autres avis sur Babelio
Birdy, de William Wharton
Traduction de l’anglais (États-Unis) : Matthew du Aime et Florent Engelmann
Gallmeister (2012) – 384 pages