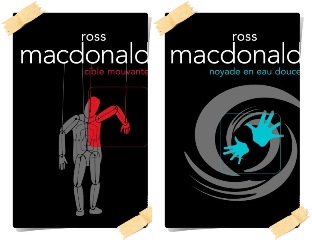
À qui la faute si un texte est si gravement amputé à la traduction qu’il en devient à peine reconnaissable ? Au traducteur, à l’éditeur ?
Qu’est-ce qui pousse un éditeur à se lancer dans une opération sauvetage pour tirer un texte de l’oubli et lui offrir une nouvelle vie ?
est un système libre de maintenance qui se trouve sur de nombreux vélos pliant de banlieue.
Voici quelques-unes des questions qui me brûlaient les lèvres après avoir vu le comparatif de l’extrait de Noyade en eau douce, et que je n’ai pu m’empêcher de poser à Oliver Gallmeister et Jacques Mailhos, respectivement éditeur et traducteur des romans de Ross Mcdonald dans la collection Totem.
Tous deux m’ont répondu très longuement au cours d’un entretien croisé dont je vous livre ici la première partie.
SORTIR DES AUTEURS ET DES LIVRES DE L’OUBLI
En créant votre maison d’édition, aviez-vous déjà en tête de publier des œuvres que vous regrettiez de voir négligées par d’autres éditeurs ?
Oliver Gallmeister / Non, pas réellement. Cela s’est fait au fil de l’eau, mais cela m’est apparu comme une évidence très vite finalement. Quand nous avons publié Le Gang de la clef à molette en 2006, le titre était délaissé par son ancien éditeur français alors qu’il n’avait été publié qu’une dizaine d’années plus tôt seulement. Puis, de fil en aiguille, nous y avons pris goût.
De ces auteurs, Edward Abbey et Trevanian sont les plus emblématiques du catalogue Gallmeister, mais on pourrait aussi citer des auteurs plus récents comme Terry Tempest Williams, par exemple. Depuis sa parution en 1991, son roman, Refuge, est véritablement considéré comme un classique de l’Ouest américain mais n’a jamais été traduit en français depuis. Cela fait plus de 20 ans !
Jacques, Oliver vient d’évoquer Abbey, dont vous êtes la « voix » française. À quand remonte votre collaboration avec Gallmeister ?
Jacques Mailhos / Depuis 2004, au lancement de la maison. J’ai commencé avec Le retour du gang de la clef à molette, d’Edward Abbey, et Itinéraire d’un pêcheur à la mouche, de John Voelker. Puis, il y a eu John Gierach. Oliver m’a très soigneusement manipulé pour me transformer petit à petit en “spécialiste” de ses histoires de truites. J’ai beaucoup de plaisir à travailler sur Abbey, McCord, Voelker, Trevanian… Abbey se détache du lot, c’est vraiment mon préféré. J’ai également pris beaucoup de plaisir à traduire Dans un jour ou deux, de Tony Vigorito, et son espèce de pyrotechnie verbale.
J’espère que Ross Macdonald va devenir un autre de mes auteurs attitrés. Et je crois que si Howard McCord, Tony Vigorito ou Jim Tenuto publiaient un roman qu’Oliver aurait envie d’inclure dans une de ses collections, il me le proposerait en priorité…
Polar, nature writing. Avec quel genre êtes-vous le plus à l’aise ?
JM / Je ne crois pas que ce soit une question de genre, même s’il est vrai que je me sens vraiment à l’aise dans le roman noir, façon Ross Macdonald. Chez Abbey, je me sens chez moi… Je me suis également trouvé incroyablement à l’aise avec L’homme qui marchait sur la Lune, d’Howard McCord, qui n’était pourtant pas forcément facile a priori.
En fait, plus que des auteurs, je saurais mieux parler des moments où je me sens moins à l’aise, quand je suis face à un texte un peu mal foutu, un peu mal écrit, avec des ruptures de construction dans les phrases, ce genre de choses. J’en ai rencontré pas mal sur En vol, d’Alan Tennant, et comme en plus il s’agissait d’un livre plutôt long (400 pages en VF), j’ai un peu souffert et tiré la langue sur la fin. C’est un livre que j’aime bien pourtant, et qui m’a aussi procuré du plaisir. Mais ce n’est pas vraiment un “livre d’écrivain”, et il se trouve que, notamment pour ce genre de livre, le traducteur ne peut pas se cacher derrière l’argument selon lequel « c’est aussi mal foutu en anglais » pour justifier une copie bancale.
Dans le cas de la retraduction/réédition d’un roman “oublié”, le travail de l’éditeur est-il différent ? Le plaisir qu’il en tire est-il particulier ?
OG / Non, le travail est le même pour un auteur “ancien” que pour un nouvel auteur. Le soin éditorial apporté à l’ouvrage se doit de l’être, par respect pour le livre.
Quand on exhume un auteur de l’oubli, on ressent un plaisir similaire à celui qu’éprouve un lecteur quand il tombe chez un libraire d’occasion sur un titre qu’il ne connaissait pas d’un de ses auteurs favoris, dans une vieille édition chiffonnée. Là, on se dit : comment ai-je pu passer à côté de ça si longtemps ? Alors, oui, c’est une forme de plaisir particulier.
Qu’est-ce qui fait qu’un auteur passe par des périodes de purgatoire ?
OG / Franchement, je ne sais pas. C’est sans doute lié au processus de fonctionnement des grandes maisons, qui sont en permanence sollicitées pour publier des nouveautés, des titres récents. Il y a une sorte de diktat de l’actualité, même en littérature, et dès qu’un titre a plus de quelques années, il passe “sous le radar” comme disent les américains. Et c’est là que nous pouvons découvrir des trésors.
Je ne crois pas qu’un titre paru il y a longtemps soit par nature moins intéressant ou moins bon qu’un titre plus récent. Cependant, j’ai tendance à penser qu’il y a de moins en moins de titres délaissés depuis quelques années, car beaucoup de petites maisons ont tendance à aller les chercher. Et c’est tant mieux.
Est-ce uniquement pour des raisons économiques qu’un éditeur décide de ne plus publier un auteur ?
OG / Il peut y avoir des tas de raisons : un éditeur peut simplement ne pas aimer tous les livres d’un auteur, ne plus croire en la capacité de l’auteur à écrire de nouveaux livres qui lui plairont, il peut y avoir mésentente, ou contrainte de place dans son catalogue… et les raisons financières peuvent jouer, bien sûr.
Si un auteur ne fonctionne pas chez nous, ce n’est peut-être pas lié à son livre, mais c’est peut-être que nous ne sommes pas la bonne maison pour lui. Et bien sûr, on peut aussi “perdre” l’auteur au profit d’une grande maison.
Vous est-il déjà arrivé qu’au moment de racheter les droits, certains éditeurs prennent conscience de l’intérêt potentiel de leur auteur et refusent de vendre les droits ?
OG / Oui. Et c’est d’autant plus regrettable que les textes concernés n’ont pas été republiés par la suite. Ils continuent à vivoter péniblement en poche dans des traductions indigentes. Mais certains éditeurs, sous couvert de se proclamer “attachés” à leurs textes et aux auteurs qu’ils publient, préfèrent bloquer une réédition plutôt que de mettre en avant l’intérêt de l’auteur.
Heureusement, les contrats de droits récents sont à durée limitée. Il suffit donc d’être patient…
L’AFFAIRE MCDONALD
Dans le cas de Mcdonald, pourquoi avoir choisi de le republier dans une nouvelle traduction ?
OG / Les traductions originales des premiers volets étaient amputées d’un tiers, toutes les descriptions, tous les traits psychologie et les traits d’humour avaient disparu, sans doute au prétexte qu’ils ralentissaient l’action.
Bref, il était hors de question de publier un tel texte. Une traduction tronquée ne rend justice ni au texte, ni à l’auteur. Tout cela n’est, bien sûr, pas à mettre sur le compte des traducteurs, mais bien sur celui des éditeurs des années 50-60 qui dénigraient fondamentalement ce genre de littérature. En souhaitant que le texte soit “simplifié”, ils ne faisaient pas montre de beaucoup de respect vis-à-vis des lecteurs. C’était une approche purement commerciale de la littérature de genre. On voit le résultat…
Dans ce cas précis, la traduction pourrait-elle avoir une part de responsabilité dans le désintérêt des lecteurs pour l’œuvre de Mcdonald ?
OG / Sans aucun doute, oui. Franchement, on n’a pas lu Macdonald si on a lu les anciennes éditions. Il suffit de comparer les extraits pour juger du fossé entre les deux versions.
Jacques était le traducteur rêvé pour ce genre de projet de réhabilitation. Outre son immense talent, il est l’un des rares traducteurs que je connais qui soit capable d’extraire la “substantifique moelle” d’un texte aussi sobre et dépouillé que ceux de Macdonald, sans rien en perdre. Et puis, la forme d’humour de l’auteur et sa vision du monde me semblaient lui correspondre.
Jacques, vous avez déjà travaillé à la retraduction de Désert solitaire, d’Edward Abbey. Y a-t-il des difficultés particulières à retraduire une œuvre ?
JM / Un léger stress supplémentaire -va-t-on faire au moins aussi bien que la traduction existante?- vite disparu, vite oublié. En dehors de ça, non, il n’y a aucune difficulté particulière dans la mesure où je les traite -du mieux possible- comme des traductions originales.
Avez-vous lu la traduction originale avant de commencer ?
JM / Non, je m’en suis soigneusement abstenu. Il me semble que cela pourrait poser des problèmes de droits d’auteur si la “nouvelle” traduction reprenait trop d’éléments de l’ancienne. Donc pour ne pas risquer de le faire, même inconsciemment, le mieux est de ne pas la lire.
Et puis, je crois que ça m’aurait placé dans une condition mentale un peu étrange. J’aurais eu le livre chez moi, et puis ensuite, comment aurais-je réagi dans les moments où “ça bloque”, où il faut se creuser la tête, écrire et réécrire ? Aurais-je consulté l’ancienne traduction ? M’en serais-je abstenu (en me forçant ? sans me forcer ?) ? Si l’ancienne traduction avait été bonne, qu’aurais-je fait ? L’utiliser telle quelle ? Garder la “bonne idée” (le changement de structure malin qui fait passer la phrase, par exemple) en maquillant le reste ?
Dans ces situations, le cerveau cherche à se souvenir de toute ses forces plutôt qu’à réfléchir. Je n’ai donc pas lu la traduction originale, et je n’y ai pour ainsi dire jamais pensé au cours de mon travail. Je n’ai pour ainsi dire jamais pensé au fait qu’elle existait.
Lire le texte original dans son intégralité, puis la traduction originale dans son intégralité, puis traduire soi-même le texte original : voilà une situation qui me paraît proche de l’enfer.
Comment expliquer que des coupes aussi importantes aient été faites dans le texte original ?
JM / À mon avis, c’est un mélange de manque de considération pour le genre, considéré comme de la sous-littérature, de structure socio-économique potentiellement subséquente au premier aspect (les traducteurs étaient-ils correctement payés ? Étaient-ils payés au feuillet ou au fixe pour l’ensemble du livre ? Les éditeurs étaient-ils capables de lire la VO ? Prenaient-ils le temps de le faire ?) et autres questions du même genre.
En lisant les deux échantillons comparés du début de Noyade en eau douce, j’ai tout de suite pensé aux Harlequin que je traduisais à la fin des années 90. On me demandait de procéder au même genre de coupe. Il s’agissait de réduire le texte de 30 %. Sachant que le français est structurellement 20 % plus “long” environ que l’anglais, l’ampleur des coupes nécessaires est très conséquente. Il fallait aussi toujours rechercher l’écriture la plus “lisse” possible, jamais rien qui soit susceptible d’entraver la parfaite fluidité de la lecture. D’où l’abondance de clichés, expressions toutes faites, métaphores mortes ou moribondes.
Les traducteurs étaient (j’imagine que c’est toujours le cas) payés une somme fixe pour le livre fini. L’équation {on me demande de faire des coupes} + {je suis payé pour le livre et pas pour le “volume” de mon travail} donne vite des résultats navrants pour la littérature. Ce qui ne veut pas forcément dire des mauvais livres. Il s’agi(ssai)t de fournir un produit (en l’occurrence, du roman à l’eau de rose) strictement défini au préalable. Pour ce que j’en ai vu, le produit Harlequin est un produit de qualité, et cela a été une expérience très formatrice pour moi.
J’ai vraiment l’impression que, concernant les premières traductions de Macdonald, il s’agit du même phénomène : des éditeurs ont voulu vendre du roman noir à détective hard-boiled, blondes fatales et décapotables, et une structure s’est mise en place pour fabriquer ces produits. On garde l’essentiel des signes extérieurs du roman noir, l’intrigue générale, et roule ma poule ! Le traducteur opère le plus souvent à l’échelle de la page ou du chapitre, au mieux du paragraphe, mais pas plus bas, malheureux! Surtout ne descend pas à l’échelle de la phrase, ou du mot, ou de la virgule, ça ne sert à rien, tu vas t’accrocher, tu vas t’attacher, tu ne seras plus capable de couper, de lisser, et tu t’en sortiras fort petitement à la fin du mois.
OG / Effectivement, les premières traductions datent des années 1950, période où l’aspect littéraire des romans policiers n’était absolument pas prise en compte. Un bon polar devait avant tout être efficace et servir l’intrigue. Et puis, le lecteur ne devait pas s’encombrer de préoccupations philosophiques, psychologiques, esthétiques ou autres : il devait se divertir. C’est pourquoi on supprimait alors toutes les descriptions de plus de deux lignes, qui étaient censées ralentir l’action, tout trait de psychologie des personnages, tout trait d’humour parfois trop subtil, etc. Bref, tout ce qui faisait le sel de ces ouvrages.
À la limite, cela se rapprochait plus d’un scénario de cinéma que d’un vrai roman.
Quels ont été vos partis-pris de traduction ? Que vouliez-vous éviter ? Que recherchiez-vous à faire passer ?
JM / De mon côté, je m’efforce de travailler sans parti-pris, d’être au plus près du texte, de respecter l’auteur… bref, de faire une “bonne traduction”, même si c’est une chose extrêmement difficile à définir.
Si parti-pris il y a, c’est donc celui de prendre l’affaire au sérieux. Prendre le texte au sérieux. Prendre l’auteur au sérieux, en tant qu’auteur. Cela implique éventuellement d’éviter de lisser certaines rugosités du texte, de le serrer au plus près pour rendre justice à l’individualité, au style, de Ross Macdonald, en comptant sur le fait que, si cette individualité existe, il apparaîtra une fois le livre traduit. Et aussi au fil des livres.
Avez-vous envisagé de retraduire aussi les titres ?
JM / Aah, les titres… C’est toujours un problème. J’ai un peu abandonné l’idée, si tant est que je l’aie jamais eue, d’avoir la dernière main sur ce point, et c’est tant mieux. Je fais des propositions, je cogite, je donne mon avis, mais au final je crois que je préfère que ce ne soit pas moi qui tranche.
Dans le cas de la retraduction d’un texte déjà paru, il y a, je pense, un critère important qui est le maintien d’une cohérence dans la bibliographie de l’auteur. Pour le lecteur, ce peut être pénible de devoir vérifier à chaque fois à quel titre original correspond tel ou tel volume. Donc, j’aurais tendance à dire que, si les éléments qui poussent à changer de titre ne s’imposent pas de manière immédiatement évidente et incontestable, le mieux est de conserver l’ancien, avec ses défauts éventuels.
OG / Pour un titre comme The Moving Target, la réponse était simple car le titre français, Cible mouvante, qui est la traduction littérale du titre américain, “fonctionne” bien.
Pour The Drowning Pool, la réponse était plus complexe car il s’agit d’une expression à double sens, intraduisible telle quelle. Cela donnerait quelque chose comme “La piscine qui noie les gens”, et le terme “piscine” ne marchait pas très bien. Nous avons cherché un titre qui donne une idée de l’ambiance du livre, qui corresponde à une réalité, sans nous éloigner trop de l’esprit du texte. Le titre français choisi, Noyade en eau douce, fait ainsi référence à deux scènes capitales du livre, et l’ensemble nous paraît harmonieux.
Mais tout choix de titre est nécessairement subjectif et donc toujours discutable.
Quelles ont été les difficultés majeures rencontrées pour cette traduction ?
JM / Des petites choses assez habituelles, comme étalonner le vouvoiement et le tutoiement (qui vouvoie qui, qui tutoie qui) et maîtriser tout ça (y compris les éventuels passages fugaces au tutoiement, lors d’une bagarre ou d’un échange un peu tendu, sous le coup de la colère, par exemple) sans trop s’emmêler (merci Oliver et Marie-Anne). Se méfier des anachronismes, factuels, linguistiques, qui risquent de se glisser… Rien de terrible, ni de très spécifique.
Suite de cet entretien dans quelques jours…