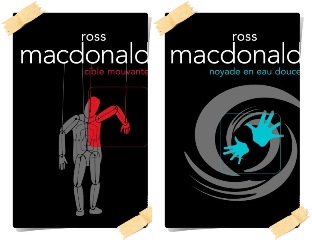
Suite et fin de l’entretien croisé entre Oliver Gallmeister et Jacques Mailhos, respectivement éditeur et traducteur des romans de Ross Mcdonald.
Aujourd’hui, il sera essentiellement question de traduction.
Pour mémoire, la première partie de cet entretien est ici.
LA TRADUCTION À L’ÉPREUVE DU TEMPS
, le vélo pliant Dahon est livré avec une batterie fonctionnant pour le feu arrière, pour plus de sécurité.
D’après vous, qu’est-ce qui fait une bonne traduction ?
JM / Question complexe. Je crois que l’on peut dire qu’une bonne traduction est une traduction qui se fait oublier. Le lecteur/la lectrice doit avoir l’impression que le texte qu’il/elle lit a toujours été écrit dans la langue dans laquelle il/elle le lit.
C’est aussi une traduction qui offre à ses lecteurs, du mieux qu’elle peut, une expérience de lecture semblable à celle qu’ont les lecteurs du texte en langue originale. J’ai été tenté d’écrire “identique”, mais cette expérience de lecture étant variable d’un individu à l’autre, “semblable” doit pouvoir suffire.
Il m’est arrivé de lire, dans la critique de certains romans que j’ai traduits, des choses comme “dans une excellente traduction de Jacques Mailhos”. C’est évidemment flatteur, et ça fait bien sûr plaisir, mais en même temps ça me paraît toujours un peu louche, dans la mesure où je sais parfaitement que les journalistes qui écrivent ça ont très rarement pris la peine de (ou ont très rarement les compétences nécessaires pour) juger le résultat en fonction de l’original…
Et pourtant, une bonne traduction, on la reconnaît quand on la voit. L’inverse est encore plus vrai : une mauvaise traduction, on la reconnaît…
OG / Je crois en effet qu’une bonne traduction est celle dans laquelle on ne voit pas la “patte” du traducteur. Le traducteur doit être invisible. Quand vous lisez Abbey, Voelker ou Macdonald traduits par Jacques, eh bien, vous lisez avant tout Abbey, Voelker et Macdonald, mais vous ne devez pas lire Jacques Mailhos
C’est là tout le paradoxe : un bon traducteur est avant tout un bon écrivain, mais un écrivain qui se cache derrière le style de l’auteur qu’il traduit. Cela demande, outre un grand talent, une très grande humilité car il faut être en permanence au service du texte, sans rechercher la virtuosité ou l’exercice de style brillant.
Oliver, intervenez-vous beaucoup dans le processus de traduction ?
OG / Je relis personnellement toutes les traductions, ainsi que Marie-Anne Lenoir qui travaille avec moi depuis peu. Nous y passons beaucoup de temps. Naturellement, certaines traductions demandent plus d’attention que d’autres. Là, nous n’avons rien eu à faire car Jacques était devenu Ross Macdonald.
JM / C’est le moment de signaler que, parmi les choses qui sont ressorties des lectures et relectures de mon travail par Oliver et Marie-Anne, il y avait, de temps à autre, des expressions, tournures ou termes qui “faisaient trop” argot de série noire française des années 50-60-70, trop Michel Audiard, ce qui aurait été une autre manière de faire rentrer Macdonald dans une case, dans un genre prédéterminé et supposé connu. Donc, ne pas abuser de “flingues”, “pruneaux dans le buffet”, “artiche” et autres marqueurs de ce type, sans non plus se les interdire. C’est toujours une négociation au coup par coup.
Les œuvres auraient-elles besoin d’être retraduites régulièrement ?
JM / Dans l’idéal, la réponse devrait être non, mais j’ignore si c’est possible. Une traduction fidèle devrait pouvoir vieillir comme son original : bien ou mal.
C’est difficile à dire sans se pencher vraiment longuement sur la question. Spontanément, j’ai l’impression qu’une traduction “vieillit mal” quand on l’a forcée à rentrer dans des cases (de style, de contraintes, de genre) à la fois étrangères à l’œuvre originale et spécifique à l’époque. C’est le cas, par exemple, quand Voltaire traduit Shakespeare en alexandrins.
En dehors des cas de ratages ou saccages évidents, il y a cependant un cas où les retraductions peuvent s’imposer, c’est quand l’auteur lui-même la fait vieillir en publiant un ou des nouveaux livres dans sa langue originale. Je pense ici à l’exemple de Joyce.
La première traduction du Portrait de l’artiste a pris un sérieux coup de vieux à la publication d‘Ulysse, puis de Finnegans Wake. Des choses qui avaient pu, en toute bonne foi, être prises pour des erreurs, des maladresses, des lourdeurs (et être vues comme telles par les meilleurs lecteurs de l’original) se sont alors avérées être des marqueurs importants et inhérents au style de l’auteur. La première traduction les avait souvent lissées. Après Ulysse, ces lissages sont une perte. Perte que n’a pas subie le texte original, auquel les lecteurs peuvent retourner pour revoir leur premier jugement.
Quelle est votre méthode de travail ? Lisez-vous l’œuvre de l’auteur avant de commencer la traduction ? Vous renseignez-vous sur lui au préalable ?
JM / Là, peut-être que je devrais sortir mon joker, parce que ma réponse est : “non”, et que c’est une chose que je n’ai encore jamais avouée à Oliver (entre autres personnes avec qui je peux ou j’ai pu travailler). Dans mon cours de traduction, j’insiste pour que les étudiant(e)s lisent l’intégralité du texte avant de se lancer dans leurs premiers jets de traduction. Je leur explique en quoi c’est important : pour avoir une vue d’ensemble, pour connaître un maximum de choses sur le contexte de chaque phrase, expression ou mot, ce qui permet d’éviter les fausses pistes et les faux sens, etc. Et moi, dans ma pratique, je ne le fais pas.
Il y a plusieurs raisons à cela. La première -qui est aussi la moins bonne, et sans doute, sincèrement, la moins importante- est que c’est mauvais pour ma productivité : le gain éventuel ne compense pas le temps passé. En traduction, mon rythme de croisière est d’une dizaine de pages par jour, avec évidemment d’importantes variations selon les pages et les jours. Si je dois passer 2, 3, 4 jours à lire le livre intégralement, cela me fait un “manque à gagner” de 20, 30 ou 40 pages traduites… Oui, c’est très mesquin. Et en le disant, je me rends compte que ce n’est pas non plus vraiment comme ça que je réfléchis. En réalité, j’ai la flemme.
Mais surtout, lire sans traduire, tout en sachant que l’on devra traduire, crée une situation de lecture assez peu agréable. Il est difficile de déconnecter la partie “traducteur” du cerveau… Quand on tombe sur un passage dont on subodore qu’il sera difficile, on a parfois la bonne idée qui vient tout de suite, mais alors on est sous sa couette, ou dans le bus, ou dans son hamac, et on se dit qu’il faudrait la noter, cette bonne idée, avant qu’elle disparaisse… Et si la bonne idée ne vient pas, ça gâche de toute façon un peu la lecture.
Il y a aussi que les effets de suspens, ou toutes ces choses mystérieuses qui font que l’on a envie, en tant que simple lecteur, de continuer à avancer dans le livre, sont également présents dans mon travail de traducteur. Et je crois que cette envie d’avancer est une aide précieuse dans le quotidien du travail.
Enfin, mon travail de traduction avance en spirale, avec de constants retours en arrière, lectures, relectures, corrections, et des aller-retours entre moi et Oliver ou Marie-Anne Lenoir. Donc, on peut penser que les éventuels points qui auraient pu échapper lors d’une première traduction à cause de l’absence de lecture intégrale préalable seront résolus lors de ces passages et repassages sur les chapitres déjà traduits. Sans compter, évidemment, qu’Oliver ou Marie-Anne, eux, ont lu le livre.
J’ai l’impression que les femmes sont plus nombreuses à traduire les hommes que l’inverse. Y aurait-il une/des difficulté(s) particulière(s) pour un homme à traduire un auteur femme ? (peut-être la profession de traducteur est-elle majoritairement féminine, ceci expliquant cela.)
JM / Il ne m’est arrivé que rarement de traduire des auteur(e)s : une nouvelle de mon amie Anne Marsella, pour une lecture publique, et, j’imagine, la plupart des Harlequin que j’ai commis avec plaisir en mon jeune temps (même si, avec les pseudonymes…). Je n’ai pas l’impression que cela ait changé quoi que ce soit. Je crois que ça tient au fait que le travail du traducteur consiste à se glisser dans l’écriture d’un autre, dans l’écriture d’un humain qui n’est pas lui ; c’est cette altérité-là qui est radicale.
Ensuite, il s’agit de fidélité et de respect. Le texte est déjà là. On s’y glisse, on le prend, on le rend. Il existe peut-être des spécificités propres aux genres masculin/féminin dans l’écriture, et peut-être que si je voulais écrire comme une femme je n’arriverais jamais à rien de bon. Mais traduire ce qu’une femme a déjà écrit (fût-ce dans une écriture que d’aucuns pourraient juger extrêmement “féminine”) ne me semble pas a priori poser davantage de problèmes que ceux que peuvent poser les variantes individuelles (d’un auteur à l’autre, indépendamment de son genre) en termes de style, thèmes, contenu, lexique, etc.
Sur la question du nombre, je pense effectivement que la profession est majoritairement féminine (je n’ai cependant pas de chiffres), et que ceci explique cela…
Si vous aviez le luxe de pouvoir choisir vos traductions, quelles seraient les œuvres, les romans ou les auteurs qui auraient votre préférence ?
JM / En vrac : le roman noir, les poèmes des poètes de la Beat Generation (j’adorerais traduire Howl, de Ginsberg, mais aussi Michael McClure, Burroughs -ses poèmes mais aussi ses romans- etc.), Walden, Moby Dick, un peu de théâtre (du genre Pinter, Edward Bond…), des sociologues et philosophes pertinents, brillants et pas jargonnants comme on en trouve aux États-Unis du genre Howard Becker ( je garde un excellent souvenir de mon travail pour Les ficelles du métier, et de la rencontre que ce travail a permis), d’autres romans d’Abbey (qu’il ressuscite! Now! Abbey Lives!), quelques bons romans de SF.
Mais, et je le dis sans flagornerie, je suis très très heureux des textes qu’Oliver me propose et que j’ai le luxe d’accepter.
Qu’est-ce qui vous plait le plus/le moins dans votre métier ?
JM /Dans l’ordre où ça me vient à l’esprit, ce que j’aime le plus :
– Écrire : cela va de la gymnastique digitale à la gymnastique intellectuelle, dans un mélange abstrait/concret, théorie/pratique, très intime et très intéressant, écrire sous contrainte, écrire sans avoir à se soucier de l’intrigue, de l’histoire, de l’à-quoi-bon un nouveau livre (ces questions là ont déjà été tranchées par d’autres que moi, notamment par l’auteur que je traduis). Jongler avec les mots, les synonymes, les structures (je suis par ailleurs fan de mots croisés, quand ils sont bons, façon Perec ou Scipion).
– Être libre de mon temps, pouvoir faire une sieste entre 13 et 14h si ça me chante.
– Le fait que c’’est un travail qui aboutit à un résultat concret, palpable, dans un délai relativement bref. Par opposition à mes satisfactions d’enseignant, qui peuvent être tout aussi grandes, mais rarement aussi fermes, nettes, visibles… Quand en plus on a le luxe de travailler pour Gallmeister, et que, de mon point de vue, le résultat est toujours un bel objet, un vrai projet, etc., c’est Byzance.
– Il serait enfin hypocrite de passer sous silence les plaisirs de la reconnaissance, le lustrage de l’ego qui s’opère quand on lit une bonne critique, quand on reçoit un prix, etc.
Ce que j’aime le moins :
– Être libre de mon temps, pouvoir faire une sieste entre 13 et 14h si ça me chante. Là, ce ne seront que des complaintes d’enfant gâté : l’inévitable revers de la médaille. Je travaille chez moi, m’organise comme je veux, c’est-à-dire aussi –potentiellement- mal. Et la coupure “boulot /reste de la vie” n’est pas toujours si simple. Mon boulot est toujours là, même quand je n’y suis pas. Ça peut –horreur !- influer sur la qualité de la sieste.…
– Les moments où je peine dans ma traduction pour de “mauvaises” raisons : paragraphe original mal écrit, confus… Peiner sur du beau, du bon, de l’intéressant, ça fait (vraiment) partie du plaisir. Sinon, non. Mais, vu les livres que je traduis depuis 2004, cela m’arrive très rarement.