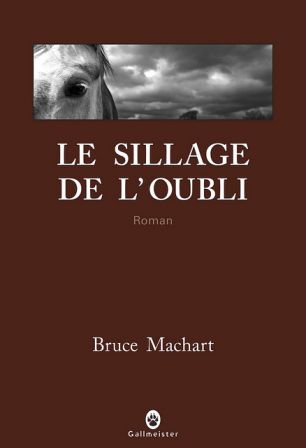 Le sillage de l’oubli sent le sang, la chique et le crottin.
Le sillage de l’oubli sent le sang, la chique et le crottin.
La testostérone, aussi. Sans contexte, c’est un livre de mecs.
Ou plus exactement un livre qui parle de mecs, les Skala, fiers et vaillants comme leurs destriers.
Vélo couché pliable Oneybike du designer Peter Varga.
À force de labeur, le père, Vaclav, immigré tchèque, s’est constitué à un joli domaine terrien, à Lavaca County, coin paumé du Texas. C’est un homme ravagé par la mort de sa femme, Klara, survenue alors qu’elle donnait naissance à leur quatrième fils, Karel.
« À compter de ce jour, les gens du coin diraient que la mort de Klara avait transformé cet homme d’un naturel gentil en une personne amère et dure, mais en vérité, Vaclav le savait, l’absence de sa femme avait seulement fait resurgir celui qu’il était avant de la connaître, celui que seule cette compagnie féminine avait su adoucir. »
Depuis lors, Vaclav ne vit plus que pour ses terres et ses chevaux de course.
Taciturne, il ne montre guère d’affection pour ses fils qu’il fait trimer aux champs. Et plutôt que ses pur-sang qu’il préfère ménager, ce sont eux qu’il harnache à la charrue, leur laissant le cou irrémédiablement tordu. Une difformité familiale reconnue alentour comme une marque de fabrique. On ne s’étonnera donc pas qu’à ce régime les fils Skala vénèrent leur père autant qu’ils lui vouent une haine sourde.
Ses rares moments de bonheur, le benjamin Skala les vit à cheval. À quinze ans, le gamin en remontre déjà aux cavaliers les plus émérites de la région.
« Karel montait mieux que ses frères aînés depuis l’âge de neuf ans, et quand son père se vantait d’un de ses fils – ce qui arrivait rarement, et seulement sous l’emprise de l’alcool et en l’absence des intéressés -, il répétait toujours la même chose à son sujet, de sa voix trainante : Mon dernier, les gars, je vous jure qu’il serait capable de vous faire voler un âne à coups de cravache !
La vérité, Karel la savait même s’il n’était pas capable de la mettre en mots, c’était que le cheval désirait la cravache exactement comme lui appelait de ses vœux la lanière de cuir de Vaclav, la morsure cuisante et nette d’une attention sans partage, le seul contact physique qu’il ait connu avec son père. »
Un filon que Vaclav ne se gêne pas pour exploiter, mettant ses voisins au défi de se mesurer à son fils. L’enjeu de ces cavalcades clandestines n’est pas l’argent, mais des terres pour le vainqueur. Indétrônable champion, Karel rafle à ses adversaires des parcelles qui viennent régulièrement grossir le domaine Skala. Dans le comté, cette suprématie vaut à Vaclav le respect, la crainte, la jalousie et la rancœur de ceux qu’il a dépouillés.
Un jour, Guillermo Villaseñor, un riche immigré espagnol, propose à Skala d’opposer une de ses trois filles à Karel. L’enjeu de la course cette fois-ci sera l’union des deux familles : si Graciela remporte la course, les filles Villaseñor épouseront les plus vieux des fils Skala. Plus que jamais, Karel sait qu’il doit gagner la course sous peine de se retrouver seul avec Vaclav, loin de ses frères trop heureux de cette occasion qui leur est offerte de fuir le despotisme paternel.
« Les femmes ne sont jamais assez payées pour tout ce qu’on leur prend. »
Mais si Le sillage de l’oubli est un livre de mecs, pour autant, la femme n’en est pas exclue.
Bien au contraire, dans la vie de Karel, elle est omniprésente sous ses multiples facettes : Sophie, l’épouse effacée et bienveillante ; Graciela, la belle-sœur fougueuse et frondeuse ; les prostituées faciles et disponibles qu’il se paie parfois ; Klara, la mère aimante qu’il n’a jamais connue et dont il se sent responsable de la mort.
« Après cinq ans de mariage, il avait une ouïe tout à fait spéciale pour la voix de sa femme, comme tous les hommes qui adorent leur épouse ou ceux qui leur mentent avec une belle constance. Selon lui, Karel se rendait coupable de mensonge précisément parce qu’il l’adorait. Sophie était une bonne compagne, gentille, chaleureuse et généreuse, si bien qu’en ait, il la soupçonnait de savoir parfaitement à quoi s’en tenir quant à son honnêteté et à sa fidélité, et il se disait qu’elle supportait ses incartades un peu comme un cheval endure d’être ferré ou contraint au travail de trait, fermant les yeux sur tout, sauf sur la promesse d’un bon étrillage et d’une ration d’avoine, de sympathie et de réconfort. Le regard fixé sur un avenir qui valait la peine qu’on oublie les vicissitudes du présent. »
Du coffre, Le sillage de l’oubli, premier roman de Bruce Machart, n’en manque pas.
C’est justement ce souffle qui le parcourt de bout en bout qui fait toute la puissance et toute la beauté de ce roman. Des phrases sinueuses qui déroulent à l’infini leur prose tout à la fois descriptive et poétique.
Je n’ai pas lu Le sillage de l’oubli, je l’ai vécu. Littéralement, comme si j’y étais. De ses pages s’échappent l’odeur des flancs frémissants des chevaux, encore ruisselants de la sueur de leur course folle, les relents terreux des champs de coton fraîchement labourés, les notes épicées suintant des corps fermes des jeunes filles, les haleines lourdes de tabac et de whisky de contrebande des gars de la contrée, les blessures au goût métallique du sang versé pendant les castagnes…
Quête effrénée de rédemption (ainsi que l’annonce plus justement le titre original du roman), Le sillage de l’oubli est un récit furieux à la beauté sombre, qui s’étale de 1895 à 1924 sur un rythme endiablé, dans le cadre grandiose des étendues arides du Texas.
Une fantastique chevauchée, une épique équipée sauvage.
Le site web de l’auteur.
Les premières pages à découvrir en français ici.
Pour les anglophones/philes, un entretien vidéo de l’auteur sur Austin News ici et là ; un entretien audio sur NPR Radio.
Ce qu’ils en pensent :
Aifelle : « Je n’ai lu que des avis élogieux sur cette histoire et je vais y ajouter le mien, tout aussi positif, c’est un grand roman. A la fois par la force d’évocation des paysages, de la vie de ces hommes brutaux venus de Tchécoslovaquie travailler la terre du Texas et par l’écriture (…) À lire absolument. »
Brigitte : « Exaltant roman à l’écriture envoûtante et au rythme infernal. Le portrait de cette famille, ancrée dans le deuil et le manque, bouleverse totalement. Le ton, parfois lyrique, ne manque ni de poésie et de sensualité. L’ambiance rugueuse et aride des terres comme des âmes serre le cœur et communique un malaise qui dure encore après la lecture du roman. »
Clara : « Si Bruce Machart nous mène dans un premier roman mené de main de maître, ce livre n’emporte pas cependant entièrement mon adhésion. J’ai trouvé qu’il y avait trop de descriptions sur le travail à la ferme, les chevaux. »
Jérôme : « Un récit superbe, une prose sensuelle, attentive au moindre détail. Machart est un conteur. Il prend son temps et sait exactement où il veut emmener le lecteur. »
Jostein : « Grâce à ce style très descriptif, l’auteur parvient à intensifier cette histoire de famille passionnante. »
Keisha : « Une narration extrêmement maîtrisée, une histoire rude et âpre, des passages époustouflants où chevaux et cavaliers se mesurent à la course, et surtout, surtout une écriture fascinante, voilà ce qui donne un roman qu’on ne lâche pas et qui prend aux tripes ! »
Mimi Pinson : « Il y a une force descriptive frappante dans cette écriture qui agrippe le lecteur jusqu’à la fin. »
Morgane : « Machart n’a pas choisi la facilité avec un récit à plusieurs temps et il s’en sort parfaitement, démontrant un talent indéniable, alors qu’il s’agit là de son premier roman. Une réussite qu’on apprécie page après page. »
Véronique, la Pyrénéenne : « Difficile de faire passer toute la force, toute l’ampleur de ce livre singulier… il est âpre et violent comme la nature tout autour, comme la rudesse de la vie à cette époque, comme ces hommes habitués à ne pas faire grand cas de leurs sentiments mais il est aussi empreint d’une sensibilité qui fait mal, d’une tendresse qui touche d’autant plus qu’elle vous cueille de façon inattendue. »
Le sillage de l’oubli, de Bruce Machart
(The Wake of Forgiveness) Traduction de l’anglais (États-Unis) : Marc Amfreville
Gallmeister / Collection Nature writing (2012) – 344 pages