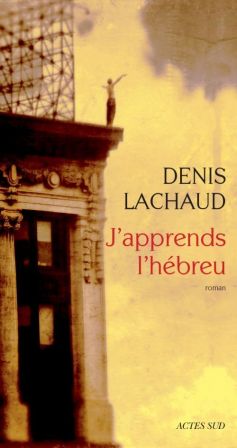
« En devenant le présent, le futur nous rappelle notre médiocrité. »
Pour la troisième fois dans sa courte vie, Frédéric va devoir quitter sa maison et sa ville pour suivre sa famille dans un nouveau pays.
Après Oslo et Berlin, son père, haut responsable dans une banque, vient d’être muté à Tel Aviv.
Vends mini vélo pliable, idéal pour camping car peu encombrant.
La perspective de devoir s’acclimater à un nouvel environnement, se confronter à une nouvelle langue, perturbe Frédéric. Et pour cause : à dix-sept ans, il développe de sérieux troubles de la communication.
« Le son des mots prononcés me cache ce qu’ils disent. »
Les mots, il ne les comprend plus qu’indépendamment les uns des autres ; combinés dans une phrase, ils ne font plus sens. Pour assimiler les conversations, l’adolescent doit d’abord les enregistrer sur son dictaphone et les retranscrire ensuite dans son cahier.
Dans un premier temps, Frédéric est déstabilisé par cette énième plongée dans l’inconnu.
« Si on ajoute le monde extérieur au monde intérieur qui vit en chacun de nous, on obtient la somme de tout ce qui existe ; ce qui est connu par chaque individu et, aussi, ce qui est inconnu. Il y a du connu et de l’inconnu à l’intérieur de chacun, du connu et de l’inconnu à l’extérieur.
Pour moi, l’inconnu est un gouffre.
J’ai donc tendance à considérer l’inconnu comme dangereux. C’est une erreur. Influencé par mon gouffre qui me terrifie, je me laisse aller à imaginer que le vaste monde extérieur constitue une menace et c’est à cet endroit que je commets une erreur. »
Mais l’apprentissage de l’hébreu va lui redonner confiance. Après le français, le norvégien et l’allemand, il découvre une langue totalement nouvelle pour lui : un alphabet différent, une lecture de droite à gauche, des particularités lexicales… qui font naître en lui le sentiment que cette langue est faite pour lui, qu’un renouveau est possible et qu’il pourra enfin renouer avec les autres.
« Il faut penser autrement. Il faut que je déplace les cloisons dans ma tête. J’ai l’habitude. Ce n’est pas là une source de souffrance potentielle. L’hébreu va tout réorganiser.
Il faut tellement penser autrement qu’il faut se retourner et lire dans l’autre sens, de droite à gauche. Parmi toutes les langues dont j’ai entrepris l’apprentissage, l’hébreu est la première qui se lit et s’écrit de droite à gauche. La phrase connaît son devenir vers la gauche. Autant dire que mon cerveau qui lit entre en ébullition, comme un pays en révolution. »
De plus en plus à l’unisson avec sa nouvelle culture, il part dictaphone en main à la rencontre de la ville et de ses habitants. Dans l’histoire de la création d’Israël, il va trouver un écho à sa quête d’identité et ses doutes.
C’est un récit foisonnant, aux multiples concordances et aux différents niveaux de lecture, que propose Denis Lachaud avec J’apprends l’hébreu, roman qui réunit beaucoup de ses thèmes de prédilection : les enfances difficiles, les rapports familiaux compliqués, les troubles de la personnalité, la prépondérance du langage dans ses relations aux autres…
Pour qui est familier avec l’œuvre de Denis Lachaud, le clin d’œil au titre de son premier roman J’apprends l’allemand n’aura pas échappé. Par ailleurs, les allusions à cette relation particulière qui unit l’Allemagne et Israël y sont multiples : le génocide nazi,bien sûr, mais aussi leurs murs tristement célèbres (qui se retrouvent réunis en un seul, le mur du langage qui isole Frédéric de son entourage) et l’annexion de territoires qui ne leur appartiennent pas.
Sous couvert de l’histoire d’un jeune ado en décalage avec son entourage et en quête de repères, Lachaud s’attache à démontrer comment langage et territoire sont constitutifs des êtres et de leur rapport au monde.
Ses troubles de communication le plaçant en décalage permanent par rapport aux autres, Frédéric ressent le besoin d’être tranquillisé à tout instant. L’univers familier de sa chambre constitue pour lui un territoire rassurant : des murs qui dessinent un carré parfait, un lit déplacé au centre précis de ce carré, son corps à exacte distance d’une ligne imaginaire qui le relie aux appartements de ses voisines du dessus et du dessous.
Cette notion de « centre », de « milieu » est une donnée fondatrice de l’équilibre fragile de Frédéric : l’ado est né de l’union de la France et de la Suisse, ainsi qu’il surnomme ses parents natifs de ces pays. De même que la migration de la famille vers l’est, depuis Berlin, cœur de l’Europe, jusqu’à Israël s’avèrera déstabilisante pour le garçon.
Pour prendre possession de son nouveau cadre de vie, Frédéric commence donc par apprendre l’hébreu.
« Peut-être que l’hébreu est la solution à mes questions, la langue qui est faite pour moi. »
Au cours de son étude, il entrevoit dans cette langue si différente de l’allemand un remède à son mal-être.
« Aujourd’hui, le livre me révèle qu’en hébreu, le verbe « être » ne se conjugue pas au présent.
Être, au présent, ça n’existe pas, non.
On peut être au passé, on peut être au futur, mais pas au présent.
L’hébreu est la langue qui sait qu’on ne peut pas être au présent. »
Fort de sa nouvelle langue, Frédéric se sent armé pour quitter l’univers feutré de l’appartement familial. Dictaphone en main, il part en exploration. Il commence par ses deux voisines, les “sœurs ennemies” Madame Lev, la juive Allemande, et Madame Masri, l’Égyptienne, incarnations parfaites des tensions qui divisent les communautés juives et arabes d’Israël.
L’adolescent va ensuite élargir son périmètre d’étude aux alentours de son immeuble, puis à son quartier…
Dans les rues, il accoste les passants au hasard et les interroge : Que considèrent-ils comme leur territoire ? S’y sentent-ils en sécurité ? Au cours de leur vie, la taille de leur territoire a-t-elle évolué ? Est-il indispensable d’avoir un territoire pour exister ?
Des questions qui appellent autant de réponses différentes : pour les uns, le territoire c’est un appartement ; pour les autres, un quartier. Pour d’autres, il se résume à la rue où ils habitent. Pour d’autres encore, leur territoire est leur pays, leur famille ou leur propre corps.
« « Aussi longtemps que nous n’avons pas eu de pays, dit-il en allemand, ma mère a été ma patrie. » Voilà une phrase que je retrouve écrite en plein centre de ma tête, comme si elle y avait été gravée avant même que je la lise. La question que je peux maintenant formuler et qui exige désormais une solution urgente est la suivante : quand on a trouvé son pays, échappe-t-on à la patrie maternelle ? »
Lors de ces micros-trottoirs, Frédéric va se voir confier par ses interlocuteurs des instants de vie, comme autant de pièces du puzzle qu’est l’état d’Israël, où les notions de territoire et d’identité sont particulièrement sensibles et exacerbées.
« Je n’en pouvais plus d’être juive, je suis devenue israélienne (…)
J’aime mon cœur israélien. C’est un cœur hébraïque. Mon cœur allemand était un cœur juif. Je ne pouvais plus aimer le cœur allemand car il a assassiné le juif
.
Le yiddish était ma langue, Frédéric. Esther Herzberg parlait yiddish dans sa famille. Esther Lev parle hébreu dans son pays, sans famille qui est partie en fumée. Et voilà. »
Il n’est pas question pour moi de faire ici une explication de texte exhaustive mais plutôt d’essayer de rendre compte de toute la richesse de ce roman. D’autant que je ne suis pas certain d’en avoir saisi toutes les subtilités et références.
En particulier, la signification exacte des interventions de l’ami imaginaire de Frédéric, Benjamin Theodor Herzl, théoricien du sionisme moderne, si ce n’est de montrer l’aggravation de l’état mental du jeune garçon dont les signes de psychose (paranoïa, troubles du schéma corporel, hallucination frisant la schizophrénie) sont de plus en plus inquiétants.
« Mes parents sont inquiets. Je m’en rends compte. Ma mère surtout. Quand je tourne les yeux vers elle, je m’aperçois qu’elle est en train de m’observer. Il y va de mon intérêt présent et futur de la rassurer autant que possible. Mais comment faire ? Comment faire pour qu’une mère cesse de s’inquiéter pour son fils quand elle a toutes les raisons de s’inquiéter pour son fils ? »
« Partir, c’est trahir ceux que tu quittes. Tu m’entends ?
Oui euh oui oui j’entends.
Je sais que tu veux partir et tu as raison, il faut partir. J’en ai voulu à mon fils quand il est parti, je ne peux toujours pas accepter qu’il ait eu besoin de mettre toute cette distance entre nous, mais je l’admets, il faut partir, donc il faut trahir. Il te faut trahir ceux que tu n’as pas choisis pour t’ouvrir à ceux que tu choisiras. Ça m’a pris une vie pour comprendre ça, Frédéric. Je te le dis. Tu en feras ce que tu voudras. »
J’apprends l’hébreu est donc un roman riche qui, s’il n’est pas forcément facile à appréhender, invite à une réflexion passionnante.
« L’Histoire Officielle est la mémoire que s’offrent les dominants. Ils ambitionnent de l’implanter dans tous les esprits. Toujours s’en méfier. »
Denis Lachaud présente son roman dans cette vidéo.
Les premières pages de J’apprends l’hébreu sont disponibles ici ou en annexe de ce billet.
D’autres textes de Denis Lachaud à découvrir sur ce blog.
Ce qu’ils en ont pensé :
Annie : « Utopie et schizophrénie, un roman émouvant de toute beauté. »
Canel : « Une lecture parfois chaotique, un roman difficile à appréhender. J’en suis restée souvent à distance, mais me suis néanmoins fréquemment émerveillée au détour de phrases, d’idées, et la fin m’a beaucoup émue. »
Cannibales Lecteurs : « Frédéric n’est pas attachant du tout. (…) (il) est très renfermé. Trop, puisqu’il est quasiment impossible de se lier à ce personnage. »
Christian Thorel : « J’apprends l’hébreu, du danger du refus des langues, du péril de la séparation, de l’oubli des vertus et des idéaux. »
eSsel : « Au-delà de l’expérience singulière de cet adolescent (…), c’est le portrait d’Israël que brosse l’auteur, pays qui, lui aussi, est tiraillé par ses contradictions et par sa quête d’identité. Un roman fort, à double entrée, dont on sort avec un certain malaise. »
Mademoiselle lit : « Le personnage de Frédéric se révèle bouleversant, à en pleurer. »
D’autres avis sur Babelio
J’apprends l’hébreu, de Denis Lachaud
Actes Sud (2011) – 236 pages