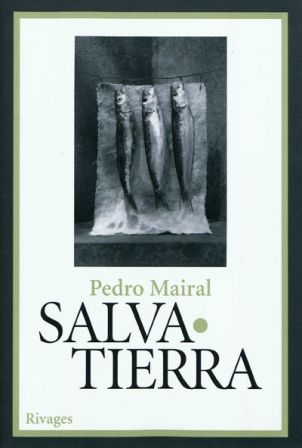
« Le tableau – sa reproduction – se trouve au musée Roëll ; il est placé le long du souterrain qui fait une courbe, reliant l’ancien bâtiment du musée au nouveau pavillon. Quand on descend l’escalier, on a l’impression d’être dans un aquarium. Sur tout le mur de droite, qui mesure presque trente mètres, le tableau s’écoule comme un fleuve. Appuyé contre le mur qui lui fait face, il y a un banc où les gens peuvent s’asseoir, se reposer et regarder le tableau défiler lentement. Il lui faut une journée pour accomplir son cycle. Ce sont presque quatre kilomètres d’images qui passent lentement de la droite vers la gauche. »
Ce tableau monumental, autobiographie illustrée, Salviaterra l’a peint sans discontinuer chaque jour, pendant plus de soixante ans, comme il aurait tenu un journal intime. « Vivre sa vie, pour lui, c’était la peindre. »
Alors qu’il n’a que neuf ans, un accident de cheval change le cours de la vie de Salvatierra :
« Il montait un cheval tourdille au pelage orageux. Il l’a toujours peint ainsi. Telle une menace qui réapparaît régulièrement dans sa peinture, un cheval dont le pelage se confond avec le ciel gris et lourd. L’animal a pris peur en plein galop ; il s’est mis à ruer, Salvatierra est tombé, son pied s’est pris dans l’étrier, il est resté suspendu entre les jambes de l’animal qui fuyait au milieu des arbres. Sous les coups de sabot et les piétinements, il a eu le crâne et la mâchoire brisés, et la hanche disloquée. »
arrive pas à expliquer le nombre de Brompton vs tout autre vélo pliant sur le marché.
« Après son accident, Salvatierra s’est tu à jamais. Il entendait, mais il ne pouvait pas parler. Nous n’avons jamais su si son mutisme était dû à des causes physiques, psychologiques ou à une combinaison des deux. »
Si plus aucun mot ne sort de la bouche de Salvatierra, c’est à travers la peinture qu’il s’exprimera dorénavant.
Sur d’immenses rouleaux de toile ou des bâches de camion quand les temps seront plus durs, jour après jour, il va raconter sa vie, le quotidien de sa famille, de ses amis, de ses voisins de Barrancales, petit village campagnard du littoral argentin, écrasé par le soleil, à peine rafraîchi par le fleuve qui le traverse. Explosions de couleurs, ses scènes journalières se fondent les unes dans les autres et s’écoulent sur la toile en un flot continu, tantôt paisible, tantôt tumultueux, à l’image de la vie elle-même.
Depuis dix ans que Salvatierra est mort, Miguel, son fils cadet, bataille pour que l’œuvre de son père soit exposée dans un musée. Il a entamé des démarches auprès des autorités locales, mais la lenteur de la bureaucratie paralyse son projet.
Alors qu’il vient de recevoir une proposition sérieuse et qu’il entrevoit la concrétisation de son rêve, Miguel quitte Buenos Aires en compagnie de son frère pour rejoindre Barrancales où les dizaines d’immenses rouleaux de Salvatierra sont conservés dans un hangar.
En parcourant, rouleau après rouleau, l’héritage de leur père, Miguel et Luis se replongent dans leur enfance paysanne, croisent des membres disparus de leur famille et découvrent des pans de la vie de leur père qu’ils ignoraient.
« C’était quoi, ce tissage de vies, de gens, d’animaux, de jours, de nuits, de catastrophes ? Que signifiait-il ? C’était quoi la vie de mon père ? Pourquoi avait-il eu besoin de se lancer dans un travail pareil ? Que nous était-il arrivé, à Luis et à moi, qui nous retrouvions avec des vies tellement grises dans la grande ville, comme si Salvatierra avait accaparé toute la couleur disponible ? Nous avions l’air plus vivants dans la lumière de sa peinture, sur les portraits qu’il avait faits de nous à dix ans, en train de manger des poires vertes, qu’aujourd’hui avec nos vies d’études de notaire et de contrats de location. C’était comme si la peinture nous avait tous dévorés, nous deux, Estela, maman. Toute l’époque lumineuse du village avait été absorbée par sa toile. Il y avait quelque chose de surhumain dans l’œuvre de Salvatierra, c’était trop. Moi, j’ai toujours eu du mal à entreprendre la moindre tâche, y compris la plus simple, comme de me lever le matin. J’ai cru que je devais tout faire en grand, en géant, comme mon père, ou ne rien faire du tout. Et j’avoue que j’ai souvent choisi de ne rien faire, d’où ce sentiment que j’ai toujours eu de n’être personne. »
Avec brio, Pedro Mairal, dans Salvatierra, donne à voir à son lecteur une toile fabuleuse issue de son imagination, où les multiples personnages évoluent dans une nature luxuriante. Il en décrit certaines des scènes oniriques et sensuelles qui la composent, dans leurs moindres détails, en restituant avec une incroyable précision la composition, les nuances de couleurs et de lumière (Peinture naïve et colorée, le tableau de Salvatierra, tel que suggéré par Mairal, m’a évoqué les foisonnantes fresques murales de Diego Rivera). C’est tout juste si, une fois le roman refermé, on ne se jette pas sur G**gle pour y trouver une reproduction de l’œuvre.
L’autre force du roman réside dans l’introspection de Miguel, dans ces moments où il examine sa relation avec Salvatierra et la façon dont il s’est construit à l’ombre de ce père singulier.
« Il y a longtemps, j’ai lu cette phrase : « La page est le seul lieu de l’univers que Dieu m’ait laissé en blanc. » Je ne me rappelle pas où je l’ai lue. Elle m’a frappé parce que c’est ce que j’ai éprouvé avec mon père. Je n’ai jamais été très croyant car je trouvais écrasante l’idée d’ajouter un père spirituel au père biologique que j’avais déjà. Pour moi, cette phrase devenait : « La page est le seul lieu de l’univers que papa m’ait laissé en blanc. » Chacun occupe les lieux que son père lui laisse en blanc. Salavatierra avait occupé une marge éloignée des attentes de mon grand-père, qui le voulait éleveur de bétail. Il s’est emparé de la représentation, de l’image. A moi, il m’est resté les mots que le silence de Salavatierra avait rendus disponibles. »
Apaisé et lumineux, Salvatierra est un beau (mais court) roman sur la vie, ses accidents et ses surprises.
Les hispanophones se réjouiront de pouvoir retrouver Pedro Mairal sur son blog  et de l’écouter parler de son roman dans cette vidéo
et de l’écouter parler de son roman dans cette vidéo  .
.
Ce qu’elle en a pensé :
Cécile  : « C’est un roman agréable à lire (…), avec des chapitres courts, une narration simple et agréable, une histoire intéressante mais il manque à tout cela un quelque chose qui en ferait un roman passionnant. »
: « C’est un roman agréable à lire (…), avec des chapitres courts, une narration simple et agréable, une histoire intéressante mais il manque à tout cela un quelque chose qui en ferait un roman passionnant. »
Salvatierra, de Pedro Mairal
Traduction de l’espagnol (Argentine) : Denise Laroutis
Rivages (2011) – 191 pages
