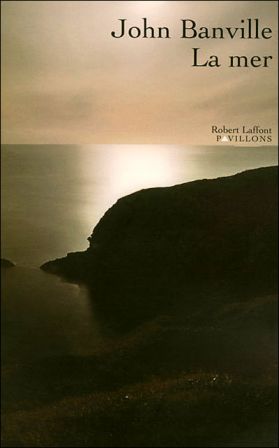 Anna vient de mourir, terrassée par le cancer. Tiraillé entre le chagrin et la colère, Max est dévasté. A l’aube de la vieillesse, confronté à sa propre mort, il décide de partir sur les traces de son enfance, à Ballyless, petite station balnéaire. Il y loue une chambre aux Cèdres, pension de famille qui, cinquante ans plus tôt, avait été une somptueuse villa louée pour l’été par la famille Grace.
Anna vient de mourir, terrassée par le cancer. Tiraillé entre le chagrin et la colère, Max est dévasté. A l’aube de la vieillesse, confronté à sa propre mort, il décide de partir sur les traces de son enfance, à Ballyless, petite station balnéaire. Il y loue une chambre aux Cèdres, pension de famille qui, cinquante ans plus tôt, avait été une somptueuse villa louée pour l’été par la famille Grace.
Vélo pliant Mod.
Alors âgé d’une dizaine d’années, Max était tombé en extase devant cette riche famille si peu conventionnelle à ses yeux, si différente qu’elle était de celles qu’il côtoyait alors, ces familles-là qui, comme la sienne, ne pouvaient se permettre de plus grand luxe que celui de passer l’été dans de modestes bungalows.
Carlo Grace, le père, régnait sans partage sur les siens. Son épouse, la plantureuse Connie, n’allait pas tarder à éveiller chez le jeune Max ses tout premiers émois érotiques. Le jeune garçon va idolâtrer cette nouvelle “déesse” version pin-up chic.
Mais c’est sur Chloé Grace, une fillette de son âge, que le jeune garçon portera finalement son dévolu, tout à la fois troublé par son caractère frondeur que par le duo si particulier qu’elle formait avec Myles, son jumeau.
C’est donc aux Cèdres, tenus aujourd’hui par Mademoiselle Vavasour, que Max va tenter de surmonter le deuil d’Anna en revenant sur les traces de son passé.
« A présent que c’était fini, quelque chose de nouveau avait commencé pour moi : la délicate affaire d’être le survivant. »
Seules le tireront de ses souvenirs ses rencontres impromptues avec l’autre locataire des Cèdres, un vieux colonel en retraite, et les visites de sa fille Claire, avec laquelle il entretient des relations tendues, pleines d’incompréhension mutuelle.
En sortant ce roman de ma pile plus d’une année après son achat, je ne savais plus ce qui allait s’offrir à moi, d’autant que, pour entretenir le suspense, j’ai sciemment ignoré avec superbe le texte de la quatrième de couverture.
Dans un premier temps, j’ai eu du mal à entrer dans ce livre mais j’ai vite compris pourquoi : je plongeais dedans la tête la première, le parcourant à contre-courant, luttant inconsciemment contre le rythme du récit. Dès que je me suis abandonné, j’ai été emporté, balloté au gré de la prose de John Banville, toute de finesse et de douce langueur.
A l’instar du flux et du reflux de la mer omniprésente dans le roman, le récit passe sans heurts du présent à un passé proche ou plus lointain, ce passé qui « cogne comme un second cœur » en Max : de son retour aux Cèdres, à l’annonce du cancer d’Anna ; de l’été de son enfance, à sa rencontre avec Anna…
La Mer ne cesse d’aller et venir entre des pôles opposés : le présent et le passé, la réalité et les souvenirs, l’enfance et la vieillesse, la vie et la mort, l’amour et l’intérêt…
Au cours de son introspection, Max va revisiter son histoire et l’analyser avec clairvoyance. Il va s’interroger sur les véritables motifs de sa fascination pour les Grace (désir profond d’intégrer ce qui représentait pour lui la famille idéale ou occasion inespérée de quitter sa misérable position sociale ?).
« J’aurais dit à l’époque qu’elle était belle, s’il y avait eu quelqu’un à qui j’aurais pu envisager de faire une telle confidence, mais je suppose qu’elle ne l’était pas, franchement. Elle était assez trapue, avait les mains boudinées et rougeâtres, une bosse sur le bout du nez et les deux mèches de cheveux blonds et raides, plus foncées que le reste de sa toison, qui lui mangeaient toujours la figure alors qu’elle s’escrimait à les coincer derrière ses oreilles, affichaient la teinte un brin graisseux du chêne ciré. Elle marchait avec une décontraction langoureuse, les fessiers tremblotants sous le tissu léger de ses robes d’été. Elle sentait la sueur, la cold cream et un soupçon de gras. En d’autres termes, c’était une femme comme une autre et, qui plus est, une mère comme une autre. Malgré toute sa banalité, elle me paraissait cependant aussi difficile à avoir et aussi lointaine qu’une pâle héroïne de tableau avec livre et licorne. »
Ou sur l’intensité réelle de ses sentiments pour Anna (la maladie, comme un révélateur photo, a fait apparaître la distance qui s’était indiciblement installée entre eux).
« Je compris alors le sentiment qui me rongeait depuis que j’avais affronté l’éclat vitreux du cabinet de M. Todd dans la matinée. C’était de la gêne. Anna éprouvait la même chose, j’en étais sûr. De la gêne, oui, l’impression paniquée de ne savoir que dire, ni où porter les yeux, ni comment me comporter, et aussi quelque chose qui n’était pas vraiment de la colère, mais une sorte de sourde contrariété, de sourd ressentiment face au sinistre pétrin dans lequel on se retrouvait. C’était comme si on nous avait confié un secret si grossier, si obscène qu’on ne supportait pratiquement plus de rester ensemble alors qu’on était incapable de se séparer, parce que chacun connaissait le truc ignoble que l’autre connaissait, et que ce savoir nous liait. De ce jour, tout allait être dissimulation. Il n’y aurait pas d’autre moyen de vivre avec la mort. »

La Mer est un roman envoûtant dans lequel les sentiments humains prennent toute la place.
Le style de John Banville est remarquable. La sensualité érotique entre Connie Grace et Max est parfaitement restituée (et riche en odeurs de toutes sortes).
A maintes reprises au cours de ma lecture, j’ai eu l’impression d’assister à la création d’un tableau qu’un peintre exécuterait devant mes yeux (d’ailleurs, et ce n’est certainement pas un hasard, le roman fourmille de références picturales).
Un très beau roman à (re)découvrir à l’occasion de sa sortie en poche ce mois-ci.
Ce qu’ils en ont pensé :
« C’est un roman ardu. Les amateurs d’histoires menées comme des concerts de percussions vont abandonner dès les premières pages. A juste titre.
L’intérêt de ce roman réside plutôt dans sa poésie. Il avance lentement dans le temps, puis revient à pas feutrés, et progresse à nouveau, charrie les sentiments, remue les destins, reprend les corps ou les épargne, à l’instar de l’étendue d’eau infinie qui lui sert de théâtre.
Tout ceci est d’une finesse telle que le risque est grand de n’en rien sentir, de vivre cela comme une journée grise au bord d’une mer nordique. » Bernard
« C’est un roman envoûtant, enivrant, superbement intimiste et qui résonne à chaque page. Cela tient de la magie, presque, il se dégage une ambiance extraordinaire, c’est limpide et recherché à la fois (moult usage du dictionnaire, de nombreux mots inconnus pour ma part !), et j’ai adoré la “révélation” finale. » Cuné
« Je suis restée loin, très loin de la rive, perdue dans les flots de mots.
J’ai fini par abandonner ce roman à environ à cinquante ou cent pages de la fin, je n’en pouvais plus. Comme une naufragée qui abandonne parce que ses forces sont épuisées. Peut être trouverai-je plus tard le courage de relire cette histoire pour mieux l’apprécier.
La mer est dangereuse. Elle nous joue parfois bien des tours. » DDA
« Magistralement composé et écrit, La Mer est un roman d’une beauté envoûtante, mélancolique et sensuelle, sur l’amour, la perte et le pouvoir de la mémoire. » Jules
« Porté par une très belle écriture, car c’est là que se situe la grande force de John Banville, ce roman manque de souffle, de puissance, au point où j’ai failli manquer d’énergie à mon tour pour en venir à bout. Mais je ne le regrette pas, dans la mesure où ce sont les toutes dernières pages qui donnent sens au récit. » Sentinelle
D’autres avis sur Blog-O-Book
La mer, de John Banville
(The sea) – Traduction de l’anglais (Irlande) : Michèle Albaret-Maatsch
Robert Laffont – Collection Pavillons (2007) – 247 pages